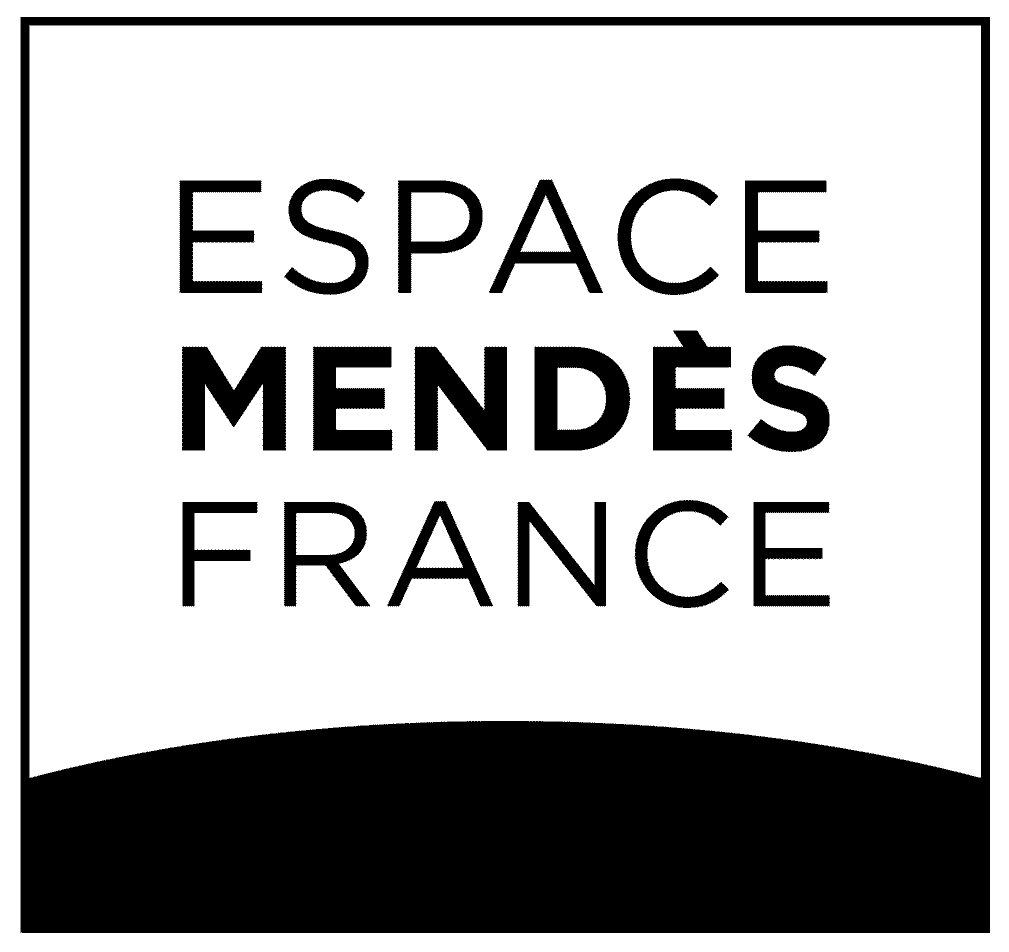Belle au naturel
 Estampe représentant une coiffure à la Belle-Poule dite "Coiffure à l'Indépendance ou le Triomphe de la Liberté" (anonyme, XVIIIe siècle, Blérancourt, musée franco-américain du château de Blérancourt).
Estampe représentant une coiffure à la Belle-Poule dite "Coiffure à l'Indépendance ou le Triomphe de la Liberté" (anonyme, XVIIIe siècle, Blérancourt, musée franco-américain du château de Blérancourt).Durant la seconde moitié du xviiie siècle, la mode n’est plus seulement d’apparat, elle doit aussi répondre à des exigences de bien-être.
Par Élodie Lecire
Les standards de beautés changent continuellement. Le xviiie siècle se trouve dans une période de transition où l’on tend à être plus naturel, qu’il s’agisse des modes d’habillements, de maquillage ou de coiffure. Ce besoin de nature est bouleversé par les nouvelles découvertes scientifiques laissant une place plus importante à la santé mentale et physique.
Pas de hula-hoop pour les petites filles !
Passé l’âge de 7 ans les fillettes sont corsetées jusqu’à l’adolescence pour lutter contre la nature de l’enfant, afin qu’elles se tiennent «bien droites». Rousseau s’insurge contre ces principes barbares en 1762 dans Émile ou de l’éducation. Soutenu par les Hygiénistes et Encyclopédistes, cet ouvrage polémique relance le débat. Mais cette remise en question de l’habillement des enfants permet aussi à la gent masculine de pointer du doigt les femmes à l’origine de ces principes vestimentaires en remettant en question leurs rôles dans l’éducation de leurs enfants.
Comme tout rituel de beauté, la mode de l’habillement des femmes et des hommes de la haute société est une pratique courante. Elle subit de nombreux changements durant la seconde moitié du xviiie siècle, affirmé par le besoin d’individualisme. La mode n’est plus seulement d’apparat, elle doit aussi répondre à des exigences de bien-être.
Au début du xviiie siècle, naît la robe à la française, qui est sûrement une des moins confortables avec l’usage de panier sur les hanches, formant une silhouette en sablier. Puis on abandonne les paniers pour l’usage d’un jupon sur lequel est déposée une sur-jupe drapée au-dessus de la cheville. Cette robe qui apparaît dans la seconde moitié du xviiiie siècle s’inspire des costumes polonais ce qui lui vaut le nom de «robe à la polonaise». Vers 1780, les paniers et les drapés cèdent la place à une robe plus simple dont l’inspiration est anglaise. Plus confortable, elle possède néanmoins un «faux- cul» lui permettant de conserver un volume à l’arrière de la jupe. Adopté notamment par Marie-Antoinette, le style anglais, libère les femmes et marque un tournant dans la mode, en accord avec le retour désiré à la nature de ce siècle.

Metropolitan Museum of Art, New-York.
Toutefois attention à ne pas sortir de chez soi en chemise de nuit ! Si la reine Marie-Antoinette donne le ton, avec son style vestimentaire, elle a été vivement critiquée dans un portrait réalisé par Élisabeth Vigée Le Brun exposé au salon de 1786. Dans cette œuvre, la reine, est vêtue d’une robe en mousseline blanche. La critique s’en était emparé pour dire qu’elle s’était fait peindre en chemise. Néanmoins, on notera encore qu’à certains moments du jour, la femme put se libérer de son corset.

Le maquillage, marqueur social
Dans son cabinet de toilette, la maîtresse de maison, donne tous les soins avantageux à sa mise en beauté. Les femmes sont éduquées pour être belles et plaire à l’homme comme ce fut le cas de Sophie dont le seul but est de devenir l’épouse idéale d’Émile (dans l’ouvrage de Jean-Jacques Rousseau).
Le maquillage n’était pas seulement employé pour cacher la dégradation du temps, du soleil ou de la maladie, c’était aussi un marqueur social. Après 1760, ces artifices sont vivement critiqués comme nous le rappelle Georges Vigarello au travers d’une citation de la baronne d’Oberkich, qui constate les mines dégradées par le maquillage, le 9 juin 1782, après le bal offert au futur tzar de Russie, à Versailles :
«Il faisait grand jour et les paysans se livrait à leur travail quotidien. Quel contraste entre leurs visages calmes et satisfaits et nos mines fatiguées : le rouge était tombé de nos joues, la poudre de nos cheveux. Le retour d’une fête n’est pas un beau spectacle et peut inspirer bien des réflexions philosophiques à qui veut en prendre la peine.»
La deuxième moitié du xviiie siècle remet en question les effets néfastes de l’artifice sur la santé, préconisant un retour à une esthétique plus naturelle. On le constate dans la représentation des visages féminins par les peintres, le choix des couleurs varie du début à la fin de ce siècle.
Dans La Toilette de François Boucher peinte en 1742, la jeune femme a le teint très blanc et beaucoup de rose aux joues. L’artiste emploie souvent la mouche sur les visages féminins qu’il peint. Dans cette œuvre, la jeune fille en possède une, près de l’œil que l’on surnomme «la passionnée». Quelques années plus tard, lorsqu’Élisabeth Vigée Le Brun se représente dans ses autoportraits, son teint est naturel, nous ne constatons que peu de rouge sur ses joues et pas de mouche. C’est avec des teintes claires et naturelles que Madame Vigée Le Brun peint tous ses portraits de femmes. Nous comprenons sa colère lorsqu’elle voit son portrait de la comtesse du Barry, peint en 1782, badigeonnée de rouge aux joues :
«J’ai fait ce tableau avec le plus grand soin ; il était, ainsi que le premier, destiné au duc de Brissac, et je l’ai revu dernièrement. Le vieux général à qui il appartient a sans doute fait barbouiller la tête, car ce n’est point celle que j’ai faite ; celle-ci a du rouge jusqu’aux yeux, et madame Dubarry n’en mettait jamais. Je renie donc cette tête qui n’est point de moi ; tout le reste du tableau est intact et bien conservé.»
Audacieuses et onéreuses créations capillaires
Pour les femmes nobles du xviiie siècle, être coiffée est l’une des obligations essentielles pour rappeler son statut social, se différencier, ou suivre la tendance du moment. À cette époque, les femmes sont coiffées à leur domicile.
Mais cette pratique coûte très cher. Pour exemple, madame de Matignon, veuve à 16 ans, une figure notable de la mode parisienne, dépense 24 000 livres par an pour qu’on la coiffe tous les jours. Soit une valeur actuelle d’environ 420 570 euros.
En 1767, le coiffeur, Legros de Rumigny publie un ouvrage sur la coiffure des dames. Il enseigne la coiffure dans son académie payante et délivre des certificats à ses élèves. Entre autres, il entend former les valets et femmes de chambre à l’activité de coiffeur.
Si les domestiques peuvent être formés à la coiffure, ils ne peuvent pas rivaliser avec un coiffeur lorsque la demande est trop complexe.
Pour une coiffure élaborée, le coiffeur propose des compositions toujours plus extravagantes, jusqu’à la «Belle Poule» en 1778. Ces créations capillaires peuvent se conserver jusqu’à huit jours, de fait, les dames s’habituent à dormir assises, pour les conserver. Des coiffures si complexes que les nombreuses heures nécessaires, pour les réaliser, justifient leur coût considérable. Un nombre conséquent de coiffures, toutes plus compliquées les unes que les autres, font la mode dans la fin des années 1770.

créée par Léonard
Pourtant, la fin du xviiie siècle marque le déclin de la perruque qui tend à disparaître, encouragée par des envies plus naturelles. Elle pose de nombreux problèmes notamment pour la santé, lorsqu’elle est poudrée.
Comme pour le maquillage, les coiffures naturelles sont revendiquées par la peintre Élisabeth Vigée Le Brun. Pourtant fille de coiffeuse, elle explique dans ses mémoires que sa coiffure ne lui coûtait pas un sou et qu’elle préférait s’arranger ses cheveux elle-même. Dans cette idée de naturel et de simplicité, M. Lefevre rédige le Traité des principes de l’art de la coiffure des femmes en 1778, expliquant aux femmes comment se coiffer elles-mêmes.
Régime léger et plein air
Avec la redécouverte de soi et de toutes les pratiques de santé, la fin xviiie siècle tend à être davantage dans le bien-être que dans le paraître.
Une définition du régime est précisée en 1765 dans le volume XIV de l’Encyclopédie. Cette pratique met en garde sur la consommation excessive d’aliment dont le but est de prévenir les maladies et de se maintenir en santé. Le souci de cette santé mentale et physique inquiète beaucoup la population.
Pour exemple, madame d’Épinay suit un régime sur les conseils du médecin Tronchin. Il lui recommande la consommation de laitage, de fruits, ainsi que des promenades en plein air. La population de cette fin de siècle cherchait à se rapprocher de la nature, dans l’objectif d’avoir une meilleure santé. De nos jours, les injonctions sont encore importantes à l’égard des femmes et de l’idéal qu’elles doivent représenter.
Bibliographie
Legros, L’Art de la coëffure des dames françoises, avec des estampes, où sont représentées les têtes coëffées, Paris, Au Quinze Vingt, 1767.
Lefevre M., Traité des principes de l’art de la coiffure des femmes, Paris, Chez l’auteur, 1778.
Mémoires de la Baronne d’Oberkirch, publié par le comte de Montbrison, dédiés à Nicolas Ier, tome 2, Paris, Charpentier, Libraire éditeur, 1853.
Stéphane, L’Art de la coiffure féminine : son histoire à travers les siècles, Paris, éd La coiffure de Paris, 1932.
Hippolyte Taine, Les Origines de la France : L’Ancien régime (1875), tome 1, Paris, Librairie Hachette, 1902.
Georges Vigarello, Le Propre et le Sale. L’hygiène du corps depuis le Moyen Âge, Seuil, 1985, et Histoire des pratiques de santé, Le sain et le malsain depuis le Moyen Âge, Seuil, 1999.
Louise-Élisabeth Vigée Le Brun, Souvenirs de Madame Louise-Élisabeth, tome 1, Paris, H. Fournier, 1835.
Cet article a été réalisé lors d’un séminaire de médiation et d’écriture journalistique dans le cadre du master histoire de l’art, patrimoine et musées de l’Université de Poitiers.