Jean-Claude Bertrand, tout un monde en musique
Par Julie Duhaut
Dans la rue Henri Pétonnet à Poitiers, non loin du magasin d’instruments de musique, se trouve un autre haut lieu de rencontre pour les mélomanes. Une vitrine remplie de disques – et de chats, pour qui s’amuse à les chercher. Entretien avec Jean-Claude Bertrand, fondateur des Mondes du Disque, un des derniers disquaires indépendants de la région.
L’Actualité. – Comment êtes-vous devenu disquaire ?
Jean-Claude Bertrand. – Même si je ne me suis jamais dit «un jour je serai disquaire», adolescent, l’idée m’a souvent effleuré. C’était un rêve car, pour être disquaire, il faut des moyens, un local, des meubles, un stock. Malheureusement, je ne les avais pas. En fait, tout a commencé dans les années 1960 : l’arrivée du rock’n’roll, des yéyés, de la musique pop a été pour moi une véritable renaissance. On écoute la radio, avec Johnny, Elvis, les Beatles, Dylan, les Stones et tous les autres. C’est un souffle nouveau, une ouverture sur un monde, dans notre tête bien meilleur, évidemment. Je fais partie de ces gens qui ont cru, à l’époque, que le vieux monde et ses atrocités allaient mourir. Parallèlement à tout ce qui vient d’Angleterre et des États-Unis, je découvre la poésie par l’intermédiaire de la chanson, Boris Vian, Prévert, Aragon… J’écoute aussi Brassens, Ferré, Brel. Puis arrive le mouvement hippie, le flower power, le pacifisme de Martin Luther King, les grands rassemblements comme Woodstock et l’Île de Wight, où j’ai eu la chance d’aller. À l’époque, on nomme cela la «contre culture» et c’est celle-là qui m’a nourri.
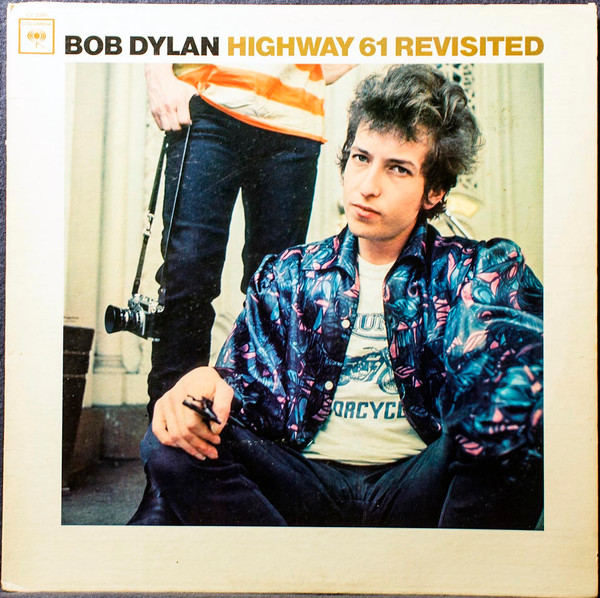
À la fin des années 1960, après une scolarité un peu chaotique, je réalise un premier rêve : je rentre à l’université en philosophie. Je garde un merveilleux souvenir de ces années. Tout va bien jusqu’à la maîtrise mais les concours ne pardonnent pas les parcours chaotiques. À partir de la licence, je deviens vacataire à la bibliothèque de la section de philosophie, donne des cours particuliers et passe de belles heures d’oisiveté. Pendant ces heures, je fréquente assidûment un lieu terrible pour mes maigres revenus, la Librairie des Étudiants, qui a un rayon disque. Un matin, je décide précisément de faire un tour dans ma librairie préférée pour échanger quelques mots avec le responsable du rayon disques, monsieur Chollet, grand amateur de jazz à qui je dois la découverte de Coltrane, Mingus, Miles Davis et tant d’autres. Mais ce jour-là, il est absent et le patron, monsieur Vergnaud, me dit qu’il le sera plusieurs jours. Personne pour s’occuper du rayon à trois semaines de Noël, il me demande alors si je peux les aider. Il est 11h30, je réponds «cet après-midi à 14 heures». C’est comme ça que j’ai commencé. Je suis resté dans le magasin jusqu’à la fin de l’année et j’ai proposé mes services en cas de besoin. Il me rappelle au mois de septembre suivant, j’abandonne alors progressivement mes cours particuliers et la bibliothèque de l’université pour devenir vendeur à temps plein avec monsieur Chollet, devenu alors mon collègue. Nous avons travaillé ensemble pendant huit ans, de 1978 à 1986.
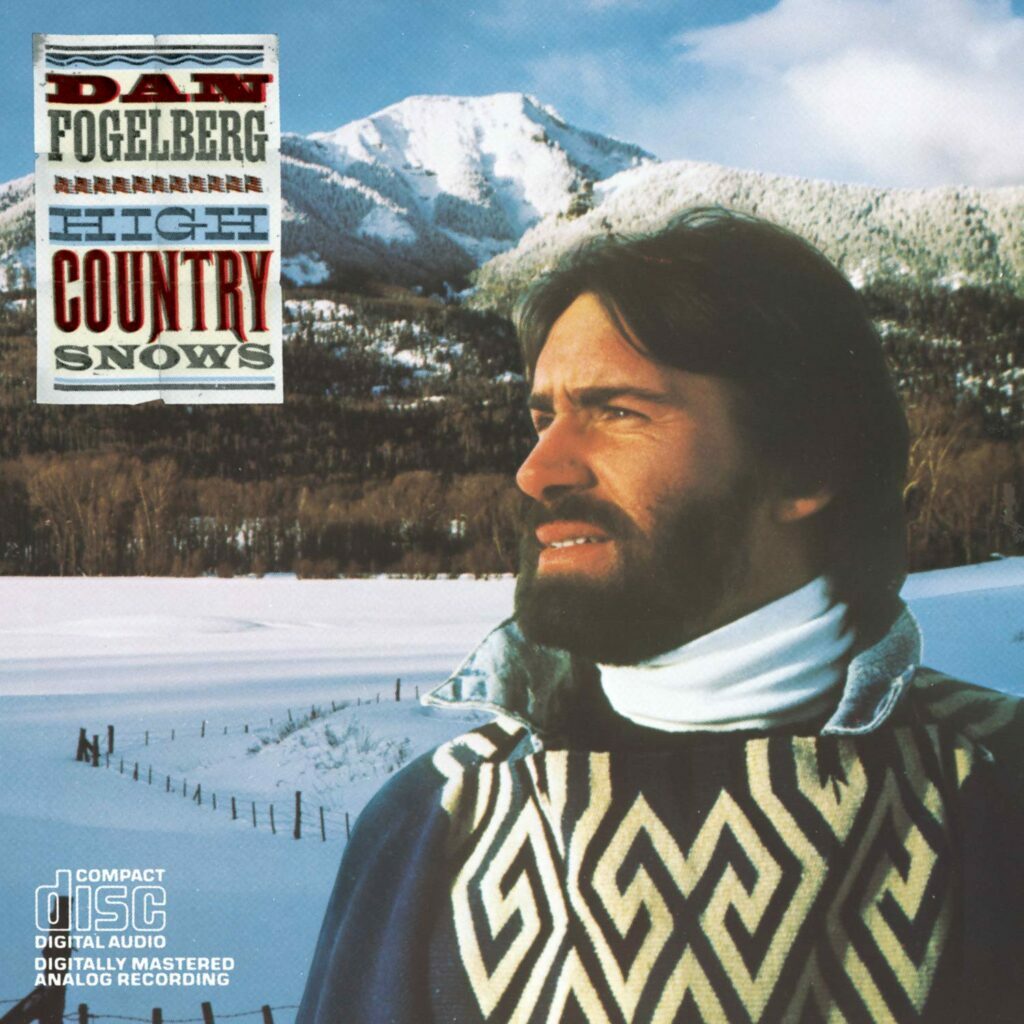
Quand mon patron prend sa retraite, il vend le magasin à l’enseigne Connexion, spécialisé dans le matériel audio, Hi-Fi, télévision, etc. Ces magasins n’ont pas l’habitude d’avoir un rayon disque mais, ayant à disposition un stock et deux vendeurs, ils nous gardent. En 1988, notre nouveau patron décide de vendre ses trois locaux dans Poitiers pour les réunir en un, en périphérie. Mon collègue a l’âge de la retraite mais souhaite continuer et je ne me vois pas aller dans une zone commerciale alors je démissionne. Nous discutons avec notre patron, monsieur Guilbaud, qui voudrait bien se séparer du rayon disque. Nous lui proposons de l’acheter et il accepte que nous lui payons mensuellement, sur un an. Sans son aide, Les Mondes du disque n’auraient sans doute jamais existé. En résumé, une passion de longue date, des rencontres, la saisie d’une opportunité sont à l’origine de l’ouverture du magasin le 2 septembre 1988.
Comment conseillez-vous les gens, qu’ils soient habitués ou occasionnels ?
Conseiller, c’est tout le charme du travail. Il faut sentir les intérêts de la personne, comprendre au mieux sa demande, poser un certain nombre de questions pour révéler ses goûts ou, si c’est pour offrir, ceux du destinataire. Souvent je commence par demander l’âge, c’est un premier repère, puis ses centres d’intérêt, ses loisirs, dans quel contexte la personne écoute de la musique. Enfin, je propose de faire écouter. J’ai besoin de tout ceci pour répondre au mieux à sa demande. J’aime l’échange autour de la musique, partager, discuter, faire découvrir. Pour moi c’est ça, cette discussion, être disquaire. Ce n’est pas seulement distribuer des disques. Un jour, dans un festival de jazz, un homme est venu me voir pour me féliciter : son épouse vient tous les ans autour de Noël pour choisir des disques à lui offrir. «À chaque fois, c’est parfait», m’a‑t-il dit. On ne peut pas me faire plus beau compliment.
Comment faites-vous la sélection ?
Les Mondes du disque est un magasin généraliste. Tous les secteurs de la musique y sont représentés, le nom même a été choisi pour signifier qu’ici, ce n’est pas une chapelle où se retrouvent des gens vouant un culte à tel ou tel genre, mais un lieu ouvert où tous les amateurs de musique et de disques se côtoient. Il y a malgré tout deux domaines qui sont absents : le rap et le metal. Je ne connais pas ces secteurs, je suis donc incapable de sélectionner ou de conseiller. La vitrine est souvent réalisée au gré de mes envies. J’aime l’idée de surprendre, de proposer des artistes qui ne sont pas forcément dans l’air du temps, de mettre en avant des musiciens vivant dans la région ou autour d’évènements de la Nouvelle-Aquitaine, comme le festival Jazz à Dissay. Je n’écarte pas pour autant les nouveautés en lien avec des revues, par exemple Diapason, Jazz Magazine, Rock’n’Folk, etc., mais ce n’est pas ce que je mets le plus en avant. Les « grandes enseignes », dont la sélection est essentiellement basée sur l’actualité et les nouveautés, le font suffisamment. Enfin, dans tous les domaines, j’ai mes indétrônables et je veille à ce qu’ils ne me manquent jamais. Ce sont des disques phares, qui n’ont pas d’âge, célèbres ou « obscurs » d’après un client anglais. Pour les enfants, Pierre et le Loup de Prokofiev et dit par Gérard Philipe, à l’origine un vinyle de 1954, reste un incontournable. Il en va de même en jazz avec Kind of Blue de Miles Davis (1959), en country music avec Dan Fogelberg, High country snows (1985), en contemporain avec Anja Lechner et François Couturier dans des œuvres de Komitas, Gurdjieff et Mompou chez ECM (2014). Mais ce ne sont que quelques exemples.
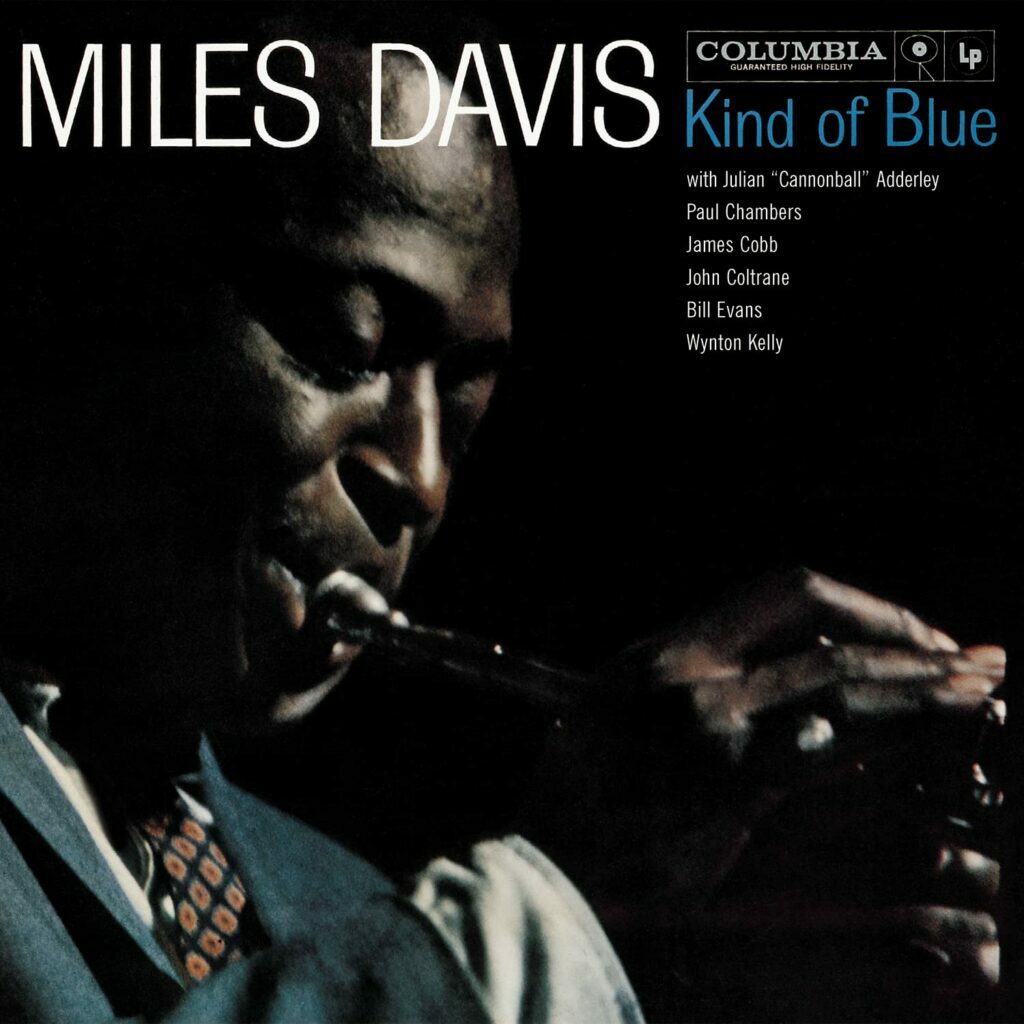
Comment recevez-vous les nouveautés ?
Tout ce qui arrive au magasin relève d’un choix personnel. Il n’y a aucun arrivage systématique de nouveautés. Il y a cependant des contraintes au niveau des commandes. Certaines maisons n’expédient les colis que si le montant de la facture atteint une somme qui m’apparaît maintenant trop élevée, compte tenu de l’état actuel du marché du disque. Si l’on atteint pas la somme requise, elles imposent des frais de port trop importants. A contrario, une structure comme Universal a nettement abaissé son franco de port, ce qui est très habile car cela permet de commander beaucoup plus souvent et donc de satisfaire plus rapidement la clientèle. En ce qui concerne les nouveautés, la majorité de l’information est transmise en ligne ou sur les sites des labels. Malheureusement, seules quelques petites structures envoient encore des documents papiers, alors que la consultation des sites est très souvent fastidieuse et qu’il n’y a pratiquement plus de correspondants avec lesquels échanger.
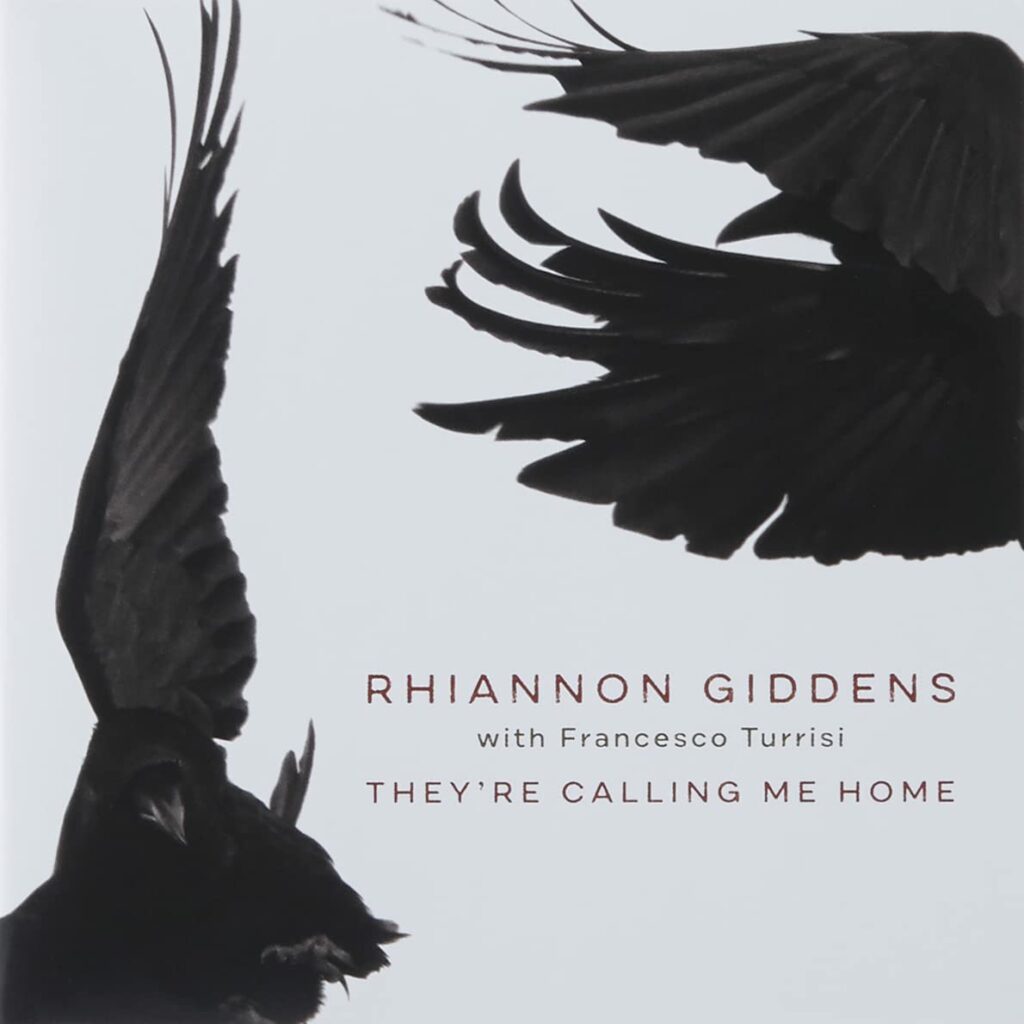
They’re calling me home, 2021.
Y a‑t-il une culture de l’objet disque ?
La culture voire le culte de l’objet disque est arrivé dans les années 1960 avec le microsillon. Le jazz, le blues, le rock’n’roll, etc., sont certes des musiques mais leur médiation par leur disque passe aussi par des images qui alimentent notre imaginaire. De grands photographes, dessinateurs et designers se sont fait connaître grâce à leur travail pour des pochettes de disque. L’arrivée des CD, au début des années 1980, n’a pas fait l’unanimité. Si le public du classique l’a immédiatement adopté, l’engouement a été beaucoup plus mitigé dans les autres domaines. On critique la petitesse de l’objet, les textes et les photos souvent illisibles, le boîtier en plastique… Bref, certains n’arrivent pas à vénérer ce petit CD argenté comme ils ont vénéré leur belle «galette» de vinyle. Car le disque a vraiment eu son heure de gloire dans les années 1960–70. Peut-être que, plus ou moins consciemment, ces réfractaires flairaient que nous étions en train de changer d’époque, que le numérique allait prendre le pas et ils refusaient que leur objet tant chéri soit relégué au rang du passé. En même temps, pour un large public, le CD est devenu la nouvelle référence. La publicité autour de ce nouveau support est énorme. Au début des années 1980, la platine CD est LE cadeau de Noël, même pour des gens qui n’écoute pratiquement jamais de musique : c’est l’objet qu’une personne voulant être de son temps doit posséder. À l’époque, l’engouement pour ce nouveau produit est tel (et c’est le revers de la médaille) que les grandes surfaces s’engouffrent avec voracité dans le marché, bien soutenues par certaines maisons de disque qui préfèrent, pour des raisons financières évidentes, mettre en place 200 CD d’un artiste dans un seul point de vente plutôt que 20 dans 10. Les grandes surfaces font du CD un produit d’appel, vendu avec une marge réduite ou compensée par une remise en amont offerte par l’éditeur. À partir du moment où les conditions d’achat ne sont pas les mêmes, où la marge perdue sur le disque peut être récupérée ailleurs et quand, à la différence du livre, le CD ne bénéficie d’aucune protection en matière de prix, parler de concurrence et de loi du marché n’a plus aucun sens. L’abattage du disquaire indépendant venait de commencer. Tout au long des années suivantes, ce sont des centaines de points de vente qui ferment. Le problème est que l’histoire ne s’arrête pas là. Comme s’il fallait parachever le travail de démolition, sont arrivés Internet, la vente en ligne et le streaming. Quelques années plus tard, soubresaut de l’édition phonographique pour résister à la dématérialisation. Le vinyle, qui n’a jamais totalement disparu, renaît de ses cendres à grand renfort de publicité. Il devient alors objet de luxe, LE support ayant soi-disant un meilleur son. Ceci est fort discutable. Avec quel appareil écoute-t-on ? La différence entre une platine haut-de-gamme et un électrophone est considérable. Les vinyles actuels sont-ils repressés à partir des matrices originales ou de leur numérisation ? Tous les disques depuis 1983 ont été enregistrés en numérique alors quelle est la différence entre un vinyle et un CD ?
Enfin, les objets réédités sont certes de qualité (vinyle 180 grammes) mais coûtent généralement très cher. Je n’ai rien contre le vinyle (je n’ai pas été un des premiers à adopter le CD) mais je trouve que le CD a une facilité et une qualité d’écoute qui n’a rien à envier à son illustre prédécesseur. Dans les années 1980, au moment où le CD et le vinyle se sont côtoyés, quand un client demandait un article, si nous lui proposions un vinyle il répondait «ah non, le CD !». Aujourd’hui, c’est plutôt «mais vous ne l’avez pas en vinyle ?». Bob Dylan avait bien dit «les temps sont en train de changer». Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette mutation : pour un public jeune c’est un nouveau produit, pour un public plus âgé c’est un retour aux sources, et la tendance vintage actuelle ne fait que conforter ce choix.
Mais qu’importe le support, comme le dit Olivier Gasnier dans une plaquette des Allumés du Jazz, Le CD a ses charmes, défendant le support physique par rapport à la musique connectée : «Mentionnons enfin que le disque porte encore avec lui la possibilité de se procurer en boutiques ou magasins, c’est-à-dire en un lieu qui devrait rester au moins autant vecteur de lien social que de commerce. Ce qui est bien souvent le cas chez les disquaires spécialisés et indépendants».

Des coups de cœur ?
Oui bien sûr ! Ils sont indissociables de mon activité de disquaire. La liste exhaustive serait trop longue mais il y a des musiques que j’aime depuis des décennies – je me rappelle par exemple avoir essayé de traduire Like a rolling stone de Bob Dylan avec mon petit dico d’anglais à la fin du collège –, et chaque jour peut m’en faire découvrir de nouvelles. C’est un échange, il m’est arrivé de découvrir un morceau en le faisant écouter à un client, pour ensuite le proposer à d’autres parce que je l’avais apprécié. J’ai quelques exemples d’artistes que j’aime et que je mets en avant depuis quelques années : en folk-blues, la chanteuse américaine Rhiannon Giddens ; en blues le magnifique album du Marcus King Band, Carolina Confessions ; en jazz, le nouvel album de Tord Gustavsen Trio, Opening.



 Espace Mendès France
Espace Mendès France
Un endroit merveilleux où j’ai eu et ai l’occasion de découvrir des pépites. Dans cet article vous révélez tout un univers que j’ai connu, étant poitevine de naissance. Votre culture, les échanges que nous avons au monde du disque, sont toujours synonyme d’ouverture, de bonheur. Mes enfants et petits enfants fréquentent votre magasin et y prennent du plaisir. Vous prenez le temps de leur faire écouter, découvrir des musiciens. Quelle chance de vous avoir