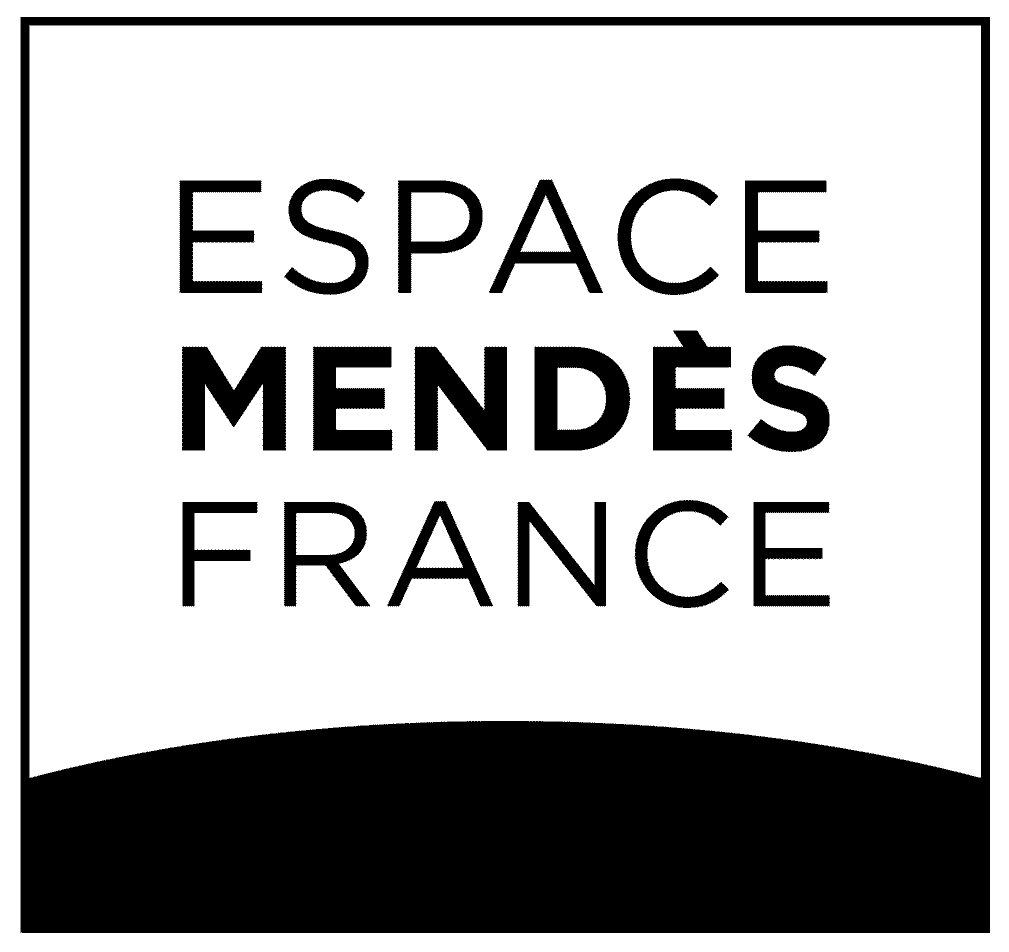Nos morts, en effigie
 Tombeau de saint Hilaire, photo Christian Vignaud.
Tombeau de saint Hilaire, photo Christian Vignaud.Trois tombeaux du Centre-Ouest de la France produits entre le xiiᵉ et le xiiiᵉ siècle permettent de mieux appréhender les pratiques et croyances entourant la mort et l’au-delà au Moyen Âge.
Par Damien Strzelecki
Les prochains Rendez-vous de l’Histoire de Blois porteront sur un sujet qui fait écho à la crise épidémique et à la hausse extraordinaire de la mortalité qu’elle a suscitée : Les vivants et les morts. La mort est effectivement une affaire de vivants, ce sont eux qui rendent les ultimes rituels, visitent le mort ou encore fleurissent sa tombe. Le tombeau est d’ailleurs le point de rencontre entre le vivant et le mort, ici se concentre la jonction entre les deux mondes, ici se conserve la mémoire du disparu. Marqueur de la sépulture et objet du souvenir, le monument funéraire est aussi révélateur des conceptions que se fait une société sur la mort et sur ses morts. C’est particulièrement perceptible au Moyen Âge, dans un contexte où la vie et la mort sont encadrées par l’Église et le christianisme. Trois tombeaux à effigie produits entre le xiiᵉ-xiiiᵉ siècle et destinés à de grands personnages poitevins démontrent les continuités, les ruptures, les évolutions en somme avec les visions modernes sur la mort.
L’image du mort au Moyen Âge
Avant de présenter les défunts, il faut définir ce qu’est une effigie funéraire. L’effigie est une représentation anthropomorphique placée sur un tombeau ou un élément commémoratif destiné à supporter la mémoire du disparu. Il existe plusieurs types d’effigies funéraires et sans doute le plus célèbre est celle du gisant tel qu’il existe à l’abbaye royale de Fontevraud (Maine-et-Loire) pour Aliénor d’Aquitaine, décédée en 1204. Outre les gisants, de nombreux autres types d’effigie existent et fréquemment ce n’est pas uniquement le corps du défunt qui est représenté, mais aussi son âme, substance faisant pleinement partie de la personne au Moyen Âge.

Commençons par l’image d’un corps et pas des moindres, celui du grand ecclésiastique Pierre II de Poitiers qui a occupé le siège épiscopal de la ville de 1087 à sa mort en 1115. Bien qu’exilé à la fin de sa vie pour avoir excommunié le comte Guillaume le Troubadour, il meurt en odeur de sainteté et est rapatrié dans la ville de son épiscopat. Son corps est inhumé à l’abbaye Saint-Cyprien, établissement qui a aujourd’hui disparu. En 1117, ses restes sont transférés à l’abbaye royale de Fontevraud et déposés dans le chœur des religieuses. Entre la fin du xiiᵉ siècle et le premier tiers du xiiiᵉ siècle, est confectionné un gisant en sa mémoire. Malgré sa disparition au fil du temps, un dessin de la collection constituée par François-Roger de Gaignières (1642–1715) nous permet de voir à quoi ressemblait le tombeau de l’évêque défunt.

Le tombeau dessiné donne à voir une scène de funérailles. Le corps couché est paré de ses vêtements épiscopaux, notamment de sa mitre et de sa crosse. Couché sur un lit, il a les yeux fermés et son chef repose sur un oreiller. L’assemblée de moines tonsurés accompagnée d’une moniale entourant le gisant signifie qu’il s’agit d’une veillée du corps qui est comme reconstituée par ces personnages figurés. Le soin du corps est alors mis en avant et le rituel des funérailles est constamment rappelé, comme rejoué sur ce tombeau.
La mort comme séparation ontologique
La mort ne signifie pas la fin de la vie dans le christianisme, mais la mort temporaire du corps et la survie de l’âme. Le bas-relief concernant saint Hilaire de Poitiers, évêque tout autant célèbre mort en 337, est significatif à ce propos. Bien qu’enterré dans la collégiale Saint-Hilaire-le-Grand au sud de Poitiers, c’est à la chapelle des Augustins, dans l’actuel rue Sainte-Catherine qu’il faut chercher son effigie funéraire. Pour cause, cet établissement, qui au Moyen Âge était le monastère Saint-Hilaire-de-la-Celle, passe pour avoir été fondé par Hilaire. Au milieu du xiiᵉ siècle, la communauté religieuse a fait réaliser un cénotaphe, dont l’étymologie grecque signifie un tombeau qui ne contient pas de corps. En effet, la dépouille d’Hilaire repose dans la crypte de la collégiale et non au monastère. L’absence du corps a alors peut-être été un argument supplémentaire motivant la réalisation de ce cénotaphe afin d’exalter le fondateur malgré l’absence de son corps. Cela marque la continuité entre l’évêque défunt du ivᵉ siècle et les vivants du xiiᵉ siècle, le fondateur mort représente une pierre d’assise sur laquelle se fonde la communauté des vivants.
Fragmentaire, le tombeau est en partie conservé, les pièces disparues ont aussi été dessinées pour la collection Gaignières [BnF, Département des Estampes et de la photographie, Res. Pe 1F, fol. 53]. L’ensemble du monument narre principalement la victoire de saint Hilaire sur l’hérésie arienne au concile de Nicée de 325 et la mort du saint évêque en 337. Cette dernière scène est le sujet du seul fragment conservé, dont l’original est visible à la chapelle des Augustins et où une copie par moulage a été placée dans la salle médiévale du musée Sainte-Croix de Poitiers. Sur cette effigie comme sur celle de Pierre II, le saint est entouré d’une foule, mais contrairement à celle du prélat mort en 1115, l’image insiste moins sur la veillée que sur le moment de mort de saint Hilaire. Le défunt vient à peine de mourir comme en témoigne son âme accostée de deux anges. La proximité de cette âme et de son corps est bien marquée au niveau de la tête du personnage. L’âme et le souffle sont traduisibles par spiritus en latin, ce que rend bien ce tombeau puisque l’expiration de l’âme se fait au niveau de la bouche, comme si le défunt venait de rendre son dernier souffle.
Le sort de l’âme après trépas
Le corps mort et l’âme extirpée, un périple attend cette dernière vers l’au-delà. Le relief encastré à l’extérieur du bras sud du transept de l’église Saint-Divitien de Saulgé de la deuxième moitié du XIIᵉ siècle invite à ne considérer que l’âme du défunt. Une inscription placée sur la bordure inférieure révèle l’identité du trépassé qui se nomme Ranulfe, noble descendant d’Agnès et dont on dit qu’il est élevé ad astra soit : vers les astres. L’écrit et l’image se répondent dans la mesure où l’âme figurée dans un encadrement en forme d’amande et les mains jointes est bel et bien emmenée vers les astres par des anges.
Le corps reste alors sur terre et c’est l’âme qui monte vers les cieux, accompagnée d’anges comme pour celle de saint Hilaire. De plus, Il faut penser que ces monuments ne sont pas seulement destinés à se souvenir ou à se recueillir, mais ils enjoignent aussi à prier pour l’âme du défunt et cela afin d’être acteur de son salut. L’âme de Ranulfe n’est pas annoncée explicitement dans les astres, mais vers les astres, sous-entendu qu’elle n’a pas encore atteint sa destination et qu’il faut l’aider pour qu’elle atteigne l’au-delà. La prière d’un tiers doit alors la soutenir pour concrétiser cette séparation entre son corps matériel destiné à pourrir sur terre et son âme immatérielle destinée à atteindre des réalités spirituelles. Ce divorce n’est que temporaire et les deux entités se réuniront pour les siècles des siècles…

Ce bref panorama permet d’entrer dans la complexité des conceptions sur la mort et ses au-delà au Moyen Âge. Le pluriel est de mise dans la mesure où la mort entraîne un ensemble de préoccupations terrestres et corporelles (funérailles), spirituelles et animiques (prière pour l’âme). Du corps à l’âme, les croyances sur la mort et ses au-delà ou ce qui lui fait suite tant dans le traitement du corps que celui de l’âme sont complexes au Moyen Âge. Ces deux entités ontologiques ne sont pourtant pas traitables séparément, si l’âme se sépare de son corps à la mort du défunt, elle doit atteindre le Paradis dans l’attente de regagner et donner son nouveau souffle au corps lors du Jugement dernier. À défaut de prier pour leurs âmes, cela invite au souvenir de ces défunts qui continuent de survivre par le biais de leur monument, lesquels sont autant des objets patrimoniaux que des reflets d’une croyance complexe entourant la mort et la mémoire au Moyen Âge.
Bibliographie
Danièle Alexandre-Bidon, La mort au Moyen Âge. XIIIᵉ-XVIᵉ siècles, Hachette, La vie quotidienne, 1998.
Caroline Walker Bynum, The Resurrection of the Body in Western Christianity, 200‑1336, Columbia University Press, 1995.
Maurice Godelier (dir.), La Mort et ses au-delà, CNRS Éditions, « Bibliothèque de l’Anthropologie », 2014.
Cécile Treffort, L’Église carolingienne et la mort, Presses Universitaires de Lyon, Collection d’histoire et d’archéologie médiévales, 1996.
Cet article a été réalisé lors d’un séminaire de médiation et d’écriture journalistique dans le cadre du master histoire de l’art, patrimoine et musées de l’université de Poitiers.