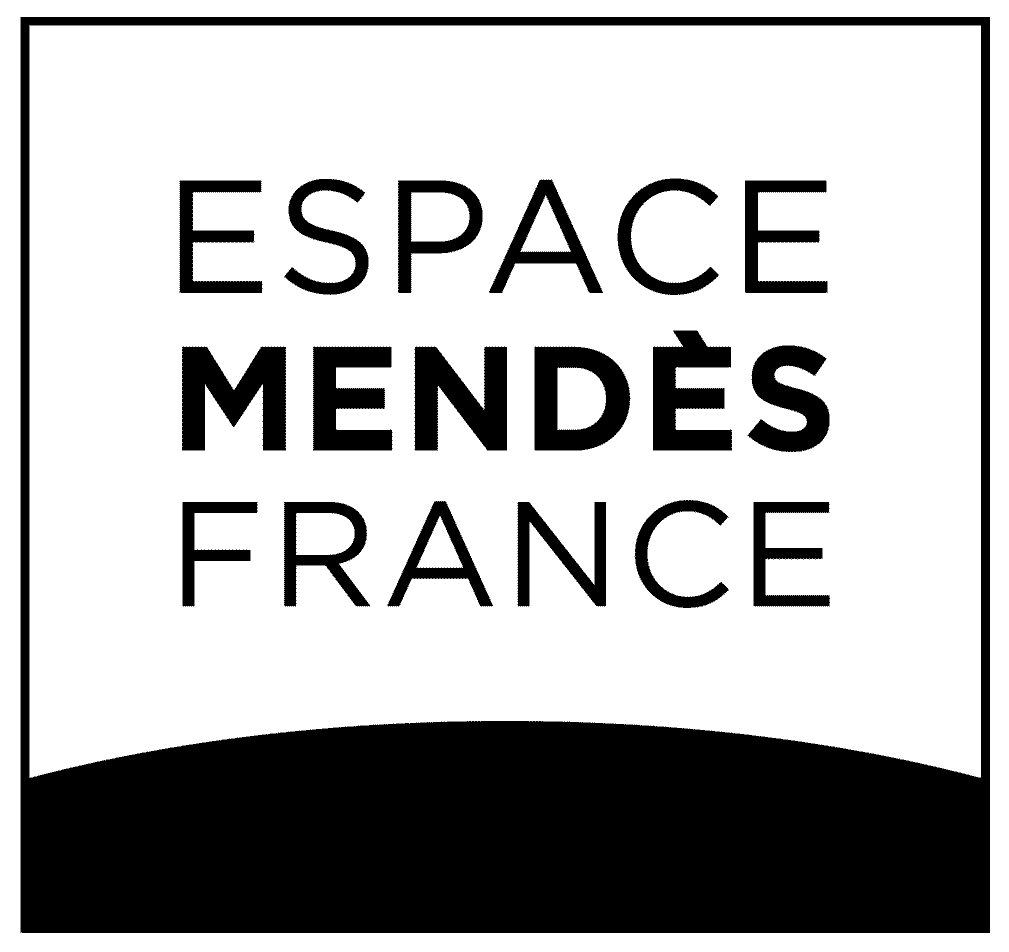Jean-Luc Chapin – Recherche de l’alchimie
 Empreintes de héron cendré, estuaire de la Gironde, 2000.
Empreintes de héron cendré, estuaire de la Gironde, 2000.Entretien Aline Chambras
La photographie est «un exercice de l’attente», nous disait Jean-Luc Chapin en évoquant sa pratique. Nous poursuivons la conversation avec le photographe, en compagnie de l’écrivain Allain Glykos, afin de mieux saisir quel cheminement, intellectuel et physique, l’amène à fixer le réel. Ou ce qu’il y voit.
Aline Chambras. – Votre territoire photographique est vaste. Mais les paysages, ou plutôt ce qui s’y cache, s’y dérobe au premier regard, occupe une part importante de votre œuvre. Comme si votre démarche tenait un peu de la quête, voire de l’enquête.
Allain Glykos. – J’aime bien le terme d’enquête. Car il est commun à plusieurs disciplines humaines. La science, la police, la chasse. La recherche (ou la fabrication) de traces, d’indices, de signes. Les traces sont comme les graffitis de la nature, les écritures que laissent les animaux sur les troncs, sur la terre, sur le sable. Je me dis qu’il y a de l’harmonique dans ton travail. Tes photos conservent aussi la musique de ton souffle quand tu as bataillé pour les réaliser.
Jean-Luc Chapin. – Oui. En ce moment, je prépare un film autour de cinq personnages extrêmes qui ont basculé dans une espèce de folie dans leur rapport à une rivière et je compte montrer le chemin qui m’a conduit à eux avant de m’arrêter sur leurs personnalités.
A. G. – Cela me fait penser à la mystique, notamment à Bouddha qui dit «tu ne peux pas être sur le chemin si tu n’es pas toi-même le chemin». Cela me fait penser aussi à l’importance que Nietzsche accordait au cheminement, à l’ascension : «Une heure d’ascension dans les montagnes fait d’un gredin et d’un saint deux créatures à peu près semblables.»
Et puis cela me fait penser aussi à cette phrase de Jean-Marc Lévy-Leblond : «La science, c’est l’art de poser les questions jusqu’à ce qu’elles trouvent une réponse. Ensuite, la réponse ce n’est plus de la science, c’est de la technique.» Lorsque je t’entends parler du chemin, je me demande si le plus important pour toi ne réside pas dans l’art de poser des questions, de chercher, de tâtonner jusqu’au moment de trouver, de faire. Et la photo, puisque tu poursuis une quête inlassable, ne serait-elle pas, non pas secondaire, certes pas, mais le tremplin sur lequel faire sauter ta pensée dans le vide chaque fois un peu plus loin ou plus haut. Au fond tu nous dis : «Vous voyez la photo et moi je voudrais vous montrer tout ce qui a conduit à la photo.» Non pas le procédé technique, mais bien plutôt la démarche, la pensée qui y a conduit. C’est devenu banal aujourd’hui de citer Léonard de Vinci (Bien que tu aies fait une série de photos sur le portrait de Saint-Anne) lorsqu’il dit : «La peinture est chose mentale.» Mais c’est bien cela que tu décris depuis le début.
J.-L. C. – Tu as raison, dans les images j’essaie d’intégrer cette idée de découverte ou de trajet, le moment où tu arrives sur un lieu après une longue quête, peut-être l’idée d’un émerveillement.

A. G. – Tu dis «découverte» et soudain il me vient qu’en préhistoire, en archéologie, on parle d’«invention». Là encore, j’ai peur d’énoncer une banalité, mais est-ce que tu découvres ou est-ce que tu inventes ce que tu vas photographier ? La manière dont tu prépares ton expédition, dont tu choisis ton matériel, tes filtres, la sensibilité de tes pellicules, le lieu, le cadrage, le moment, la lumière, etc. Tout cela est de l’ordre de l’invention, de la fabrication. Et, qui plus est, de la pensée matérialisée, pour reprendre une expression de Bachelard. Poésie vient du grec poïesis qui désigne l’acte de fabriquer, de concevoir, de construire. Quand je t’ai vu travailler, je me suis dit qu’il y avait vraiment une part de calcul dans la beauté.
J.-L. C. – «La part de calcul dans la grâce», nous dit Jean-Marie Pontévia, cette formule me poursuit depuis fort longtemps, personnellement je crois en la force du calcul.

A. G. – Quand tu pars pour une expédition, qu’est-ce que tu vas chercher ? Pourquoi aller là plutôt qu’ailleurs ? As-tu l’intuition de ce que tu vas trouver, est-ce totalement l’aventure, ou bien, comme disent certains chercheurs, tu vas chercher ce que tu as déjà trouvé ?
J.-L. C. – J’aime bien le terme d’expédition car il présuppose une préparation, une intention que l’on parte pour trois heures, trois jours ou trois mois. Hormis les sorties en «chasse libre» sur un coup de lumière je pars avec des intentions particulières, celles d’un travail en cours ou celles qui ont émergé au profit d’une rencontre (comme je te l’ai dit plus haut j’utilise le terme de rencontre sur un spectre très large, une lecture, un croisement d’idées, un mot, une discussion, un tableau, etc.). Ce qui est décisif c’est la lumière et pour les expéditions au long cours elle va engager le résultat final. Sous certaines lumières, que j’essaierai de te décrire plus tard si tu le souhaites, je suis sollicité sans cesse. Sous d’autres lumières, rien ne se passe spontanément et je dois puiser dans des stratagèmes éprouvés ou improviser. Ces expéditions ont la forme d’une quête, j’ose le mot qui, le plus souvent, signifie une grande concentration et de longs arpentages qui engagent le corps. Je reste persuadé que dans l’épreuve du corps l’esprit s’ouvre, c’est une théorie très romantique. Je trouve, je ne trouve pas, je trouve autre chose qui s’additionne instantanément aux intentions préexistantes. C’est un jeu de chaises musicales assez cruel où des idées s’affirment où d’autres s’installent et d’autres encore sont rejetées trouvant leur place dans ma mémoire prêtes à ressurgir.
A. C. – Vous faites principalement du noir et blanc ?
J.-L. C. – C’est vrai que le livre paru chez Gallimard récemment est en noir et blanc, mais je travaille la couleur depuis plus de quinze ans. Dans plusieurs livres, le noir et blanc et la couleur se mêlent. C’est le cas dans un livre paru chez le même éditeur en 2013 et dans quelques livres autour du vin. C’est une question intéressante parce que je pense qu’en noir et blanc j’ai clarifié beaucoup de choses. Alors qu’avec la couleur j’en suis encore à essayer de résoudre un certain nombre de problèmes.
A. C. – Lesquels ?
J.-L. C. – Celui de comprendre ma position devant cet immense champ de possibilités. Je m’appuie sur une part spontanée mais il y a certainement quelque chose du noir et blanc dans ma pratique de la couleur. La photographie du ru gelé exprime bien cette tension, elle a toutes les raisons du noir et blanc, la lumière a décidé de la couleur, elle me fait entrer dans un autre langage. Quand je travaille en couleur, je pense beaucoup à cette définition originelle de la photographie : «Fixer le reflet de la réalité.»
A. G. – Tu as souvent parlé de la forme lors de nos diverses conversations. Mais la moindre touche ou bande de couleur posée sur une toile définit une forme sans bordure, comme dit Richard Serra.
J.-L. C. – Je suis sensible à ta remarque, avec la couleur, ce qui m’intéresse aujourd’hui c’est de jouer d’une ambiguïté entre la photographie et la peinture, ses matières, son histoire notamment rapportée au paysage. J’ai bien conscience que c’est un fil du rasoir et que la photographie a déjà envisagé ce chemin. À moi d’en emprunter d’autres…


A. G. – J’aimerais que l’on creuse le rapport de l’esprit à la matière. Muriel Barbery, dans la préface à Natures, évoque cet aspect. Elle fait allusion à Descartes. Je suis tout à fait d’accord avec elle. Le cartésianisme nous a imposé une pensée dualiste, où l’esprit et la matière sont disjoints et quasiment incompatibles. Or toi, tu les réconcilies dans ta démarche, car tu rends visible ce lien ténu et profond entre les deux aspects de la nature dont nous faisons partie. J’ose aller plus loin. En voyant tes photos de troncs d’arbre, je me suis bien sûr dit qu’il y avait là un travail d’invention : transformer le végétal en minéral et qui sait l’inverse. Alors une expression m’est venue, «biologie minérale». Bien sûr elle exprime l’impossible, elle ferait hurler mes amis scientifiques. Ça n’existe pas la biologie minérale. Ou bien on est dans le vivant ou bien on est dans l’inerte. Je suis allé sur Internet pour voir si à tout hasard, je trouverais quelque chose qui parlerait de biologie minérale. Et à ma grande surprise, le seul article qui évoque ce terme incongru, c’est un article sur l’alchimie. Or, il y a une vieille antienne à propos de la photographie argentique et du travail de laboratoire, c’est que cela fait penser à de l’alchimie. Transformer je ne sais quel métal en une image sous l’effet de la lumière à l’abri des regards. Pratique magique, secrète, dont le photographe ne souhaiterait pas dévoiler le secret. Mais je suis sûr, enfin non pas tout à fait, que cette idée doit t’agacer. Peut-on en parler ? La confusion entre le végétal du tronc et l’effet de pierre est-elle aussi forte dans la réalité que sur la photo ? Si ce n’est pas le cas, alors tu fabriques cette minéralisation du végétal ou cette végétalisation de la pierre. Tu matérialises une intention, une idée.
J.-L. C. – Pour ce qui est de l’alchimie, peut-être suis-je resté un peu naïf ou innocent, mais malgré ma connaissance du processus, j’éprouve toujours la même sidération à la montée de l’image, ce moment magique qui transporte instantanément au cœur de l’image, loin de la rationalité du sujet. Une bonne partie de mon travail essaie d’intégrer l’idée du merveilleux, je ne sais s’il y a là une relation de cause à effet.
Quant à la matière, oui c’est ma grande affaire. C’est en bonne partie elle qui m’a poussé à continuer à travailler en argentique, elle qui va décider de l’existence même des images. Ici les pensées, comme tu le dis, et la technique se fondent en un tout indissociable. C’est la fusion d’une matière originelle, d’une lumière et d’une décision prise quant au traitement des négatifs. Les qualités attendues sur la photographie sont l’obtention d’une gamme de gris étendue, d’une sensation de volume et d’épaisseur. Ce dernier terme est le plus difficile à définir mais ce serait la part malléable de la matière, celle dans laquelle vont pouvoir s’inscrire les intentions initiales lors du tirage. Je me dois d’ajouter que cette attention particulière au négatif a pour origine l’école américaine du zone system d’Ansel Adams.
A. G. – Muriel Barbery écrit que le paysage dit mieux l’homme que ses portraits. J’ai écrit, dans Parle-moi de Manolis, que lorsqu’on regarde de très près un visage il cesse d’être visage pour devenir paysage. Ça a l’air de dire l’inverse mais en réalité je crois que ça dit la même chose.
J.-L. C. – Oui bien sûr, comme tu l’as compris ce qu’entend Muriel Barbery c’est «montre-moi un de tes paysages je te dirai qui tu es». Tout paysage n’existe que dans la matérialité de sa fabrication, de sa production et de sa monstration in fine, là où la subjectivité de tout un processus va se confronter aux regards, à la sagacité d’esprits affûtés ou à un jugement affectif. Le paysage est pure invention, une vue de l’esprit. Pour ce qui concerne l’Occident il est né dans la peinture de manière anonyme puis il a été nommé jusqu’à aujourd’hui envahir notre vocabulaire, jusqu’à dévorer le mot pays. Par sa plasticité et son origine symbolique il se prête à la métaphore : «Tout portrait est un paysage mental», serais-je tenté de te dire.
J’entends bien l’aspect formel qui est sous-tendu dans ta question sur le portrait, il est bien évident qu’un portrait profite d’un visage ou d’une attitude comme un paysage profite d’un pays. Personnellement, je pense qu’il faut perturber l’image offerte par le sujet ou, du moins, juger de sa force, de sa sincérité, je parlerais d’un «combat amical» qui, l’espace d’un instant, laissera passer un éclair de vérité, du moins il m’est nécessaire de le croire…

A. G. – Anaxagore disait que l’homme est l’animal le plus intelligent parce qu’il a une main. Je dirais volontiers que l’intelligence de ton travail de photographe est dans ce dialogue qui va de la main à la pensée et de la pensée à la main. Il y aurait là matière à penser sur la notion de geste.

J.-L. C. – Tu touches un point essentiel et je pense instinctivement aux gestes du tirage même si tu l’envisages ici de manière plus large au sens de la geste photographique.
Je reste persuadé que chaque image possède son propre rythme, sa dynamique et c’est d’autant plus vrai que personnellement je travaille dans le carré, une forme d’où rien ne s’échappe. Ce rythme est intimement lié à la décision de prise de vue et, dans la pénombre du laboratoire, ce sont des gestes interférant entre la lumière et le support papier qui vont révéler le sens ou l’essence, j’hésite entre ces deux mots, de l’image. Ajout, retenue, étalement de lumière, les mains envisagent des formes ou se font rigides pour travailler aplats, dégradés, mais le plus souvent les mouvements s’enchaînent, essai après essai, dans une succession de gestes intermédiaires répondant aux impératifs d’une vision finale. Il est effectif qu’avec le temps les gestes s’organisent spontanément répondant instinctivement à mes sensations de premier regardeur, une position particulière où les exigences semblent s’exacerber, causes d’échecs retentissants ou de joies profondes.
Bibliographie sélective
Natures, texte de Jean-Marie Laclavetine et Muriel Barbery, Gallimard, 2018.
Pêcheur, texte d’Éric Audinet, Confluences, 2013.
La table des chiens, catalogue, textes de Claude d’Anthenaise (entretien), Éric Audinet, Alain Borer, Christian Caujolle, Jean-Marie Laclavetine, Musée de la chasse, 2013.
La ville élargie, texte de Didier Arnaudet, Confluences, 2012.
Descente au paradis, texte de Jean-Marie Laclavetine, Gallimard, 2011.