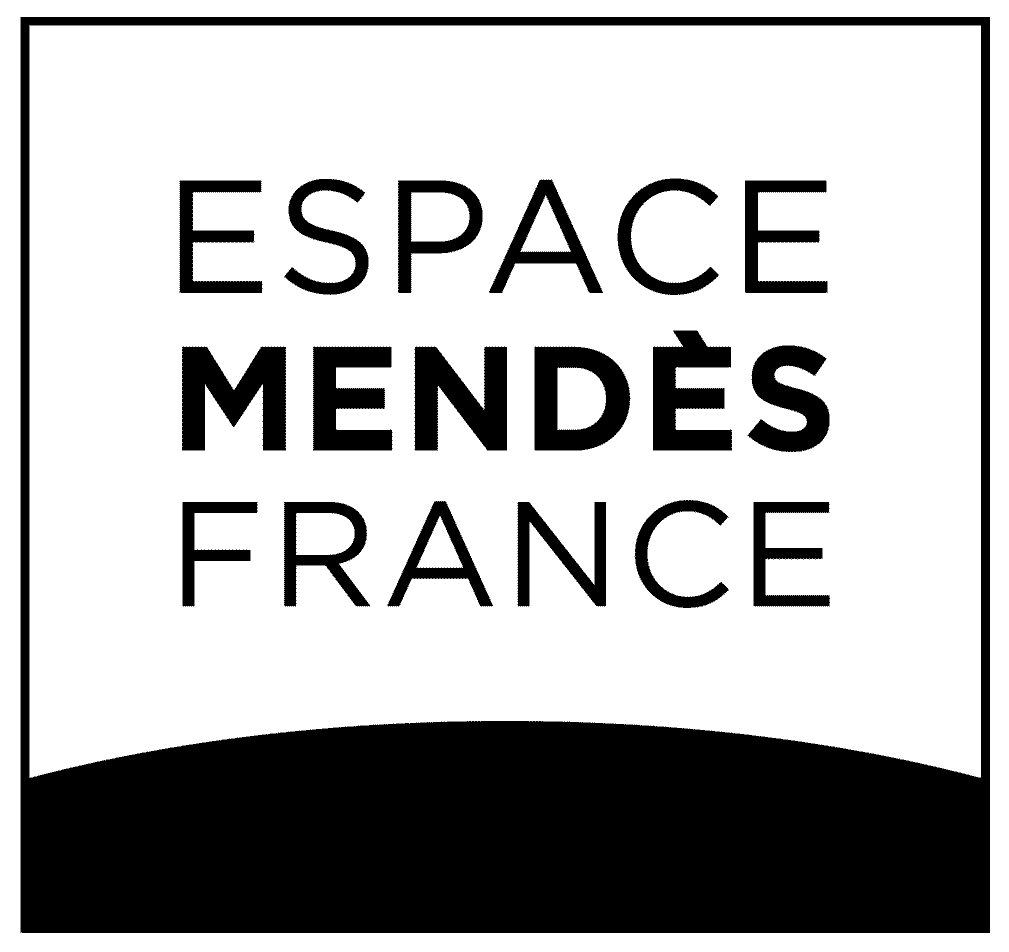Jean-Jacques Salomon — L’impérialisme du progrès
 Jean-Jacques Salomon en 2004 - Photo Mytilus
Jean-Jacques Salomon en 2004 - Photo MytilusQuel que soit le coût économique du changement de climat pour les pays industrialisés, il n’égalera pas le coût humain que les pays en développement auront à payer.
Jean-Jacques Salomon
L’Actualité Poitou-Charentes n° 66 octobre 2004
Est-ce être irrévérencieux ? Il y a de l’ironie et même de la dérision – et pourquoi pas, autant le dire, de l’hypocrisie – dans la notion de développement durable. C’est bien pourquoi elle semble si allégrement convenir aujourd’hui à tous les esprits, de droite comme de gauche, même à ceux qui s’en réclament comme d’un vœu pieux pour en faire leur commerce et leurs profits. Il suffit, en effet, de voir ce que la formule dénonce – l’idée d’un développement non durable – pour en percevoir toutes les contradictions. Durable, traduction (ou interprétation) européenne de la notion première, anglo-saxonne, de soutenable, comporte au moins deux sens : qui se maintient (ce qui dure ne change pas) et qui continue ou perdure (pas d’arrêt, c’est voué à se prolonger indéfiniment). Or, qu’est-ce qui n’est pas durable (ou soutenable) ? C’est bien le développement tel que nous l’avons pratiqué jusqu’à maintenant et continuons de le pratiquer en croyant (ou en faisant comme si nous «y» croyions) que les choses peuvent continuer en l’état malgré tous les signaux qui s’accumulent tendant à confirmer que, précisément, cela ne peut pas se maintenir et/ou que le processus peut s’interrompre et même s’achever.
Je ne sais pas si l’on peut renoncer, comme le recommande mon ami Edgar Morin, au mot développement qui en est venu, effectivement, à incarner le modèle de croissance économique dont les pays occidentaux, depuis la révolution scientifique du XVIIe siècle et à plus forte raison depuis la révolution industrielle du XIXe siècle, ont été les pionniers1. La notion de développement a une source biologique (évolution caractérisée par une croissance, extension, augmentation) au sens où l’embryon débouche sur l’animal ou l’homme comme la chrysalide sur le papillon ou le têtard sur la grenouille, et cette source a elle-même irrigué les interprétations et dérivations historiques de l’évolution humaine (techniques, économiques, philosophiques) jusqu’à devenir (passer pour) la clé de l’évolution des cultures et des civilisations : la marche irrépressible vers le mieux.
Il s’agit toujours d’un trajet et même d’une trajectoire qui mène (doit mener) d’un état de moins à un état de plus : la notion de développement est à ce point rattachée à toute l’histoire de l’Occident (celle de l’Europe, pour commencer) et à nos racines judéo-chrétiennes qu’il est difficile, en fait impossible, de la dissocier de la notion de progrès. La notion de développement apparaît plus neutre que celle de progrès, elle est tout autant messianique au sens où l’on sort des limbes vers la civilisation, ou du péché vers le salut (version religieuse), ou encore (version laïque) où l’on tourne le dos aux primitifs et aux sauvages pour accéder aux sociétés où règnent le droit, la raison, les vertus de la démocratie, etc. Bientôt nous aurons à Paris un «Musée des arts premiers», version moins condescendante des arts naguère conçus comme primitifs par les puissances coloniales, et qui signale bien un point de départ inaugural avant d’autres étapes, non pas seulement chronologiquement, mais surtout hiérarchiquement différentes. Mais différentes par quoi ? Entre ce musée et celui du Louvre, ou pour être plus concret, entre la Vénus de Brassempouy, l’art pariétal ou l’art nègre et Giotto, Goya, Picasso ou Giacometti, la trajectoire – l’évolution – se traduit-elle en termes de «progrès» ? Les arts premiers, pour parler comme André Malraux, n’appartiennent pas moins au Musée imaginaire de l’humanité que ceux qui leur ont succédé, et l’on hésitera à professer qu’ils sont «moins accomplis» parce qu’ils ont historiquement précédé.
C’est pourtant ainsi que la notion de progrès a pollué la notion du développement : l’impérialisme de la notion a imposé sa marque grâce, d’une part, à l’accroissement des connaissances (l’homme qui, suivant Pascal, grimpe sur les épaules de ses prédécesseurs pour voir mieux et plus loin) et, d’autre part, grâce aux acquis constamment renouvelés du processus industriel (la machine qui, suivant Marx, produit à son tour des machines, de sorte que «la routine scientifique détermine un développement qui n’a plus d’autres limites que celles des matières premières et des débouchés»). Et elle l’a polluée, science aidant, en particulier celle des statistiques, en la présentant comme une réalité mesurable et mesurée : le développement, voyage qui mène de la «tradition» à la «modernité», du «primaire» à toutes les étapes ultérieures dont la nôtre – comme si elles ne pouvaient être qu’ascendantes – se ramène en fait à la mesure de la croissance du PIB, le produit intérieur brut, par quoi les organisations internationales et les instituts nationaux, magistères évaluateurs de la comparaison des trajets économiques des pays les uns par rapport aux autres (OCDE, Banque mondiale, Nations Unies, comptabilités nationales, etc.), quantifient la manière dont les uns «progressent» et les autres stagnent ou même régressent. De ce point de vue, Edgar Morin a tout à fait raison de dénoncer la logique économico-technique qui imprègne de part en part la notion de développement. On le voit bien dans la distinction entre pays développés et pays sous-développés : comme chacun sait, cette formule a eu si mauvaise presse qu’on parle plutôt aujourd’hui de pays en voie de développement, ce qui montre bien que, dans le trajet qui mène «au niveau» où nous en sommes arrivés, nous autres les pays industrialisés et donc développés, ils sont, eux, engagés sur un chemin ou une pente qui n’est qu’un ou deux premiers pas vers «le développement». Formule d’autant plus hypocrite que la catégorie artificielle des pays «en voie de…» comprend des pays dont le niveau de développement peut être aussi différent que sont, par exemple, le Pérou et le Sri Lanka ou la Mauritanie et le Paraguay (parmi lesquels on a fini par introduire des catégories nouvelles, les pays les moins bien dotés, sans parler des pays de l’Est, hier industrialisés, que la fin du régime communiste a transformés en «nouveaux» pays en développement). Reste aussi la catégorie des «pays émergents», qui approchent vaillamment du sommet du haut duquel nous commençons à craindre leur concurrence et l’hospitalité qu’ils offrent à nos entreprises en voie de délocalisation…
La moindre leçon des ethnologues-anthropologues est tout de même de nous avoir appris (après Montaigne, Montesquieu ou Rousseau) que «le premier» n’est pas… primitif, que tout ce à quoi il se rattache ou dont il se réclame n’est pas inférieur par cela seul qu’il est «autre». Les sociétés qui ont précédé les nôtres ou qui passent aujourd’hui pour «primitives» n’étaient pas et ne sont pas sans «savoir», c’est-à-dire sans prise efficace, si relative qu’elle soit à nos yeux, sur leur environnement et leur devenir. N’ont-elles pas, dans le contexte historique et culturel qui était ou qui est encore le leur, cherché à leur échelle à maîtriser leur destin tout autant que nos sociétés post-modernes ? Comme l’a écrit il y a longtemps Claude Lévi-Strauss dans la publication fameuse de l’Unesco, Race et histoire, les sociétés dites primitives avaient aussi leur Pasteur et leur Bernard Palissy, et il n’est pas oiseux de mettre en perspective, donc de relativiser, tous les gains qu’au cours des âges les progrès de notre savoir ont permis aux sociétés dites avancées de remporter. Les problèmes d’encombrement et de pollution que les villes ont connus du temps de la circulation à cheval (voir les Embarras de Paris de Boileau) n’étaient pas à l’échelle de ceux que soulèvent aujourd’hui les méga- et giga-cités, dont les systèmes de gestion, de chauffage ou de climatisation, à plus forte raison de transports, contribuent au réchauffement de la planète – sans parler du fait que l’urbanisation galopante est source de violences et de menaces d’explosions civiles : c’est dans le contexte urbain que la fabrique sociale est aujourd’hui, à plus forte raison demain, la plus vulnérable en raison même de l’asymétrie croissante entre «privilégiés» et «exclus».
Mais aujourd’hui l’enjeu véritable n’est pas tant de «dépasser» le développement que de prendre acte – et d’urgence – de tout ce qui le rend précisément ni durable ni soutenable sous peine de catastrophe collective. Et cette prise de conscience, cette résolution, commence bien entendu par une réflexion critique sur l’impérialisme de la notion de progrès en termes vulgairement économiques, en particulier sur les limites des comparaisons que fonde la mesure du PIB2. Ce ne sont là que des indicateurs : ils marquent assurément les additions (ou les soustractions) dont témoigne la balance des échanges, mais ils ne rendent d’aucune manière compte de ce qui peut témoigner de la qualité de la vie (ou de l’absence de cette qualité), à tout le moins des héritages et des spécificités culturels qui n’ont plus rien à voir avec le calcul statistique – au sens où tout ce que l’on peut dire de l’aménité de l’existence, pour parler comme Husserl (ou Baudelaire), est tout simplement hors circuit mathématique.
Plus grave et plus actuel encore, derrière cet impérialisme de la notion de progrès, il y a précisément toutes les dérives et menaces caractéristiques du processus d’industrialisation : méga-urbanisation, aliénations et exclusions sociales, inégalités et asymétries entre sociétés ou nations, qu’exacerbent désormais les menaces pesant sur l’environnement.
Il y a plus d’un quart de siècle les économistes s’interrogeaient sur les moyens de mettre au point des «indicateurs sociaux» capables de rendre compte de ce qui, au-delà ou en deçà des mesures disponibles en termes de PIB, permettraient de mieux évaluer et comparer d’un pays à l’autre ce qui définit l’art (ou le désordre) de vivre et survivre en société. Aujourd’hui, comme un rappel à l’ordre des réalités naturelles et non plus seulement sociales, les limites du progrès s’incarnent dans les mesures et les analyses scientifiques qui confirment de jour en jour la réalité de l’effet de serre, du réchauffement du climat, des perturbations environnementales liées au processus d’industrialisation.
Les gaz à effet de serre, dioxyde de carbone, méthane, etc., ont certes des sources naturelles, mais l’emballement planétaire du processus d’industrialisation entraîne un réchauffement général dont les effets promettent d’être redoutables dès ce siècle. À supposer que les grands pays en développement que sont la Chine, l’Inde ou le Brésil s’industrialisent au même rythme et à la même échelle que les pays actuellement les plus industrialisés, avec des parcs automobiles, des centrales et des usines rivalisant en nombre avec les nôtres – et le scénario chinois est de plus en plus probable dans le quart de siècle à venir –, il est évident que le développement ne sera ni soutenable ni durable, entraînant du même coup non seulement des distorsions sans commun rapport avec les asymétries et inégalités actuelles, mais encore des transformations radicales menaçant la survie même d’une grande partie de l’humanité.
On s’est battu naguère encore pour la conquête de territoires, on se battra demain pour l’accès à l’eau et à l’air. De plus, et c’est l’ironie même ou la dérision du progrès, on peut déjà apprécier le réflexe contradictoire qui consiste – avec l’appui des gouvernements – à lutter contre cette menace par les moyens même qui doivent l’accélérer et l’amplifier : pour répondre à la canicule, les pays industrialisés et déjà nombre de pays en développement climatisent à outrance, de sorte qu’ils aggravent le problème en croyant y échapper. Les signaux de l’effet de serre émergent à peine des données fournies par les réseaux et systèmes d’observation météorologique, et le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (créé et patronné par l’ONU) comprend plus de 2 000 spécialistes dont les alertes sont très loin de convaincre et de mobiliser les esprits, à plus forte raison les autorités publiques. Où voit-on ce constat scientifique réellement pris en compte par les gouvernements ? Qui prend encore au sérieux de par le monde les accords de Kyoto auxquels les États-Unis, plus gros consommateurs d’énergie au monde, ont tourné le dos les premiers ? Rapports, livres, conférences et même plus récemment un film catastrophe, Le jour d’après, ont fait abondamment le point sur le sujet : «La maison brûle et nous regardons ailleurs», a déclaré le président Chirac à Johannesburg, ce qui ne l’empêche pas de regarder ailleurs, même si le regard de George W. Bush est encore plus étranger à l’idée de s’attaquer aux défis du réchauffement de la planète.
Or, «mal de Terre» ou «Terre asphyxiée», la montée des périls ne peut que renforcer du point de vue de ses effets l’accumulation des asymétries entre pays industrialisés et pays en développement. Deux sources évidentes se conjuguent pour confirmer cette tendance : la croissance démographique et l’évolution économico-technique. Tous les scénarios reviennent à montrer que, faute d’une démarche de l’humanité tout entière agissant globalement, on s’achemine vers le désastre. Et l’industrialisation croissante – apparemment inéluctable – des plus grands pays en développement ne peut que contribuer à rendre plus difficiles les solutions envisageables pour la maîtrise d’un «développement durable». D’autant plus que, dans le moyen terme, quel que soit le coût économique du changement de climat pour les pays industrialisés, il n’égalera pas le coût humain que les pays en développement auront à payer. Et dans le long terme… relisons Keynes.
Je me contenterai de citer ici ce que mon collègue le professeur André Lebeau – physicien, ancien directeur général de Météo France et président du CNES – a écrit sur la capacité de réaction de l’humanité à ce problème dont la nature, l’échelle et les répercussions possibles sont absolument sans précédent : «Nous n’avons ni expérience ni traditions sociopolitiques qui puissent nous aider à gérer nos relations avec un objet cosmique – la planète Terre – qu’on ne saurait ni menacer ni entraîner dans des compromis, avec lequel on ne peut ni biaiser ni négocier. La plupart des institutions et des traités internationaux ont été conçus soit pour traiter, par d’autres moyens que la guerre, des conflits qui agitent l’humanité, soit pour prévenir ou combattre les effets de catastrophes locales, non pour dialoguer avec le Sphinx planétaire. […] La même tentation qui pousse tel ou tel État à tricher avec les règles de l’Union européenne exerce ses effets néfastes sur la recherche de solutions : l’écartèlement inévitable entre ce que requiert la préservation des intérêts planétaires et ce qu’on appelle la défense des intérêts particuliers du groupe ou de la nation.»3
Peut-être tout simplement, de même que nous oublions l’échelle de temps propre aux changements climatiques dont la Terre a témoigné, omettons-nous de voir que dans tout processus de développement il y un début et une fin. De l’embryon à l’âge adulte, le terme véritable du vivant c’est aussi, comme dirait Bichat, la mort. Et il est significatif que l’essor de l’industrialisation ait coïncidé avec la formulation des lois de la thermodynamique, donc avec le timide début de la prise de conscience des limites que l’entropie assigne à tout développement.
L’histoire de l’humanité est après tout très récente par rapport à celle de la Terre, à plus forte raison de l’univers, pourquoi faudrait-il qu’elle soit éternelle ? La Terre en tant que planète peut certes survivre à bien des cataclysmes, mais pour les civilisations la partie n’a jamais été jouée à l’avance ni surtout au terme gagnée. Paul Valéry pensait que les civilisations sont mortelles par l’épuisement de leurs ressorts, les signaux qui nous viennent de l’espace engagent à penser que ce serait plutôt par la surabondance de leurs produits : épuisement des ressources fossiles, réduction de la biodiversité, accroissement de la consommation d’énergie et pression démographique, cette conjonction ne peut conduire qu’à des scénarios de rupture dont nous n’avons pas l’idée, mais dont nous refusons de tirer séance tenante les conséquences.
Comme dit la chanson de Prévert, «si tu crois, fillette, qu’ça va durer…» À moins d’un sursaut politique à l’échelle planétaire et/ou d’un miracle provenant de découvertes et d’innovations scientifiques capables de changer radicalement la donne des conditions de notre développement, pas de doute : nous nous gourons ! Mais peut-être faut-il une fois de plus se retourner vers l’ethnologue pour comprendre ce qu’est le véritable enjeu de ce processus qui n’est assurément ni durable ni soutenable, alors que les égoïsmes nationaux, les intérêts immédiats des uns et des autres, les pressions des lobbies industriels et les rivalités entre nations empêchent toute mobilisation planétaire pour en relever les défis. Relisons Tristes tropiques pour concevoir que le coût final du développement – du progrès – peut être bien plus élevé que la somme de ses bienfaits. Je cite Claude Lévi-Strauss dans les (presque) dernières pages du livre : «Le monde a commencé sans l’homme et il s’achèvera sans lui. Les institutions, les mœurs et les coutumes, que j’aurai passé ma vie à inventorier et à comprendre, sont une efflorescence passagère d’une création par rapport à laquelle elles ne possèdent aucun sens, sinon peut-être celui de permettre à l’humanité d’y jouer un rôle.»
1. Voir E. Morin, «Dépasser la notion de développement», L’Actualité Poitou-Charentes, n° 63, janvier 2004, pp. 28–31
2. Sur ce point, voir mes analyses, en particulier le dernier chapitre et la conclusion de Survivre à la science : Une certaine idée du futur, Albin Michel, 1999
3. A. Lebeau, «Et si George Bush avait tout faux ? Le changement climatique, un défi planétaire», Futuribles, n° 286, mai 2003
Jean-Jacques Salomon (1929–2008) était professeur honoraire du Conservatoire national des arts et métiers, conseiller scientifique de Futuribles. Il a fondé et dirigé de 1963 à 1983 la Division des politiques de la science et de la technologie à l’OCDE.
Des entretiens avec Jean-Jacques Salomon ont été publiés dans L’Actualité Poitou-Charentes : «Le rationnel et le raisonnable» (n° 36, avril 1997), «Redécouvrir la prudence» (dossier sur le principe de précaution, n° 49, avril 2000), «Ambivalence de la science» (n° 54, octobre 2001).
Portrait de Jean-Jacques Salomon par Mytilus