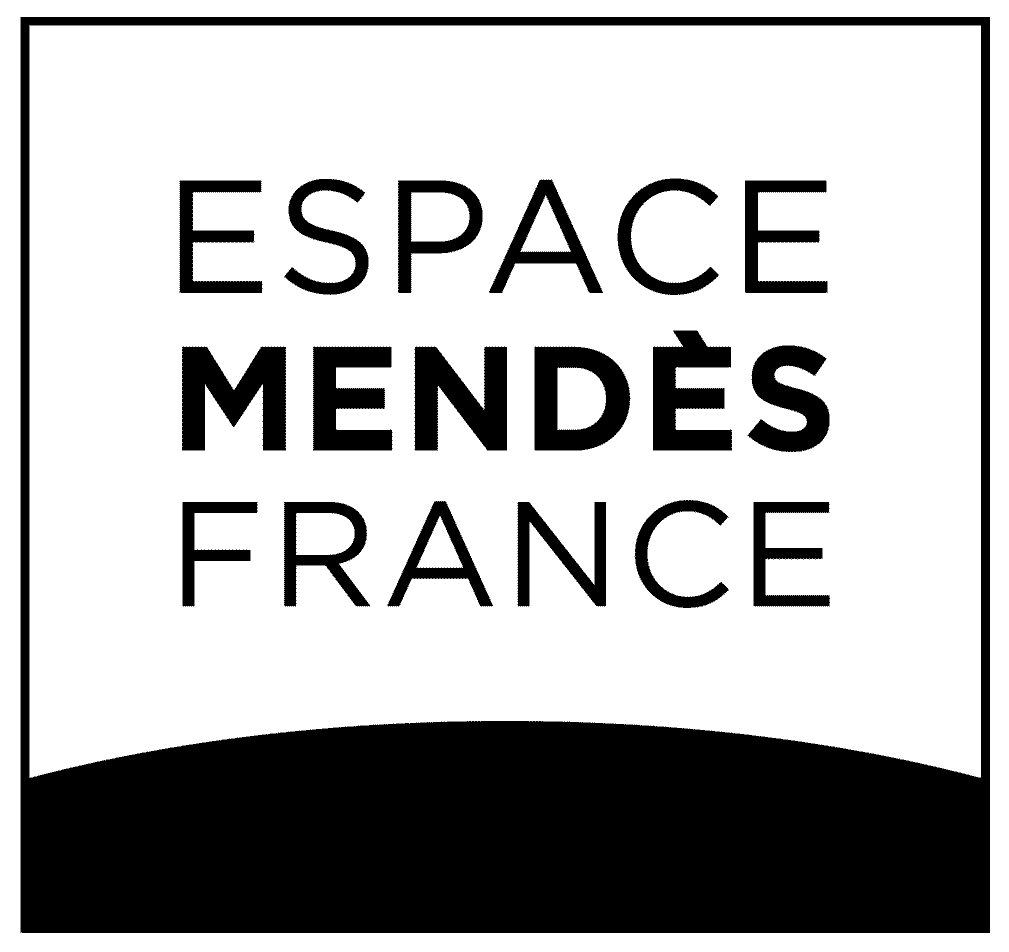Edgar Morin — Dépasser la notion de développement
 Edgar Morin à l'Espace Mendès France le 24 octobre 2003 - Photo Claude Pauquet
Edgar Morin à l'Espace Mendès France le 24 octobre 2003 - Photo Claude PauquetEdgar Morin
L’Actualité Poitou-Charentes n° 63 janvier 2004
Nous publions ici de larges extraits de l’intervention d’Edgar Morin à l’Espace Mendès France le 24 octobre 2004. En préambule, il a rappelé qu’au début des années 1970 il a co-organisé un colloque sur la crise du développement au cours duquel il avait exposé «Le développement de la crise du développement» (texte publié dans Sociologie, Points Essais). Trente ans après, il affirme que c’est à la notion même de développement qu’il faut s’attaquer. Il propose de dépasser la notion de développement, «un dépassement au sens du philosophe Hegel, c’est-à-dire à la fois aller au-delà tout en conservant quelque chose».
Pourquoi renoncer au mot développement ? Parce que le noyau de ce mot est de nature techno-économique. Il suppose que le développement technique et économique, sur le modèle des nations dites développées, est comme la locomotive qui doit naturellement entraîner derrière elle tous les wagons du développement humain : santé, démocratie, culture, rationalité, mieux-être, etc. La notion de développement est donc fondée sur une logique, je dirais même sur un déterminisme socioéconomique sous-jacent, qui oublie toute une série de déterminations, lesquelles échappent à la technique et à l’économie. D’ailleurs, il y eut des développements techniques et économiques qui n’ont pas entraîné la démocratie, etc. Dans un passé récent, ce fut le cas du Chili du général Pinochet, de l’Espagne à l’ultime époque du général Franco, de l’Union soviétique… De par son caractère technique et économique, la notion de développement se fonde sur le calcul et se mesure par le calcul. Or, le calcul ignore ce qui lui échappe. Et qu’est-ce qui échappe au calcul ? C’est évidemment la vie, c’est la souffrance, c’est l’amour, tout ce qui fait la condition humaine. Bien entendu, on peut calculer en termes monétaires le seuil de pauvreté, mais les calculs prennent plus ou moins bien en compte la réalité. En effet, dans certaines économies de subsistance, des agriculteurs vivent de polyculture et parviennent à satisfaire la plupart de leurs besoins sans recours à beaucoup de monnaie. En revanche, les mégapoles regorgent de gens jetés hors de leur terre, avec des moyens précaires, qui sont réduits à une vie de misère tout en disposant pourtant des ressources en monnaie supérieures à celles des familles vivant dans leur campagne. Le dénuement matériel est lié à d’autres aspects : l’humiliation due à la subordination, à la nécessité d’obéir, à la nécessité de mendier ; le mal-être dû à l’impossibilité d’accéder à des médicaments trop chers… Certes, de nouveaux indices ont été inventés pour tenter de mesurer cela. Comme toujours, quand un principe est insuffisant, on essaie de lui donner quelques ajouts ad hoc pour le faire tenir et, ainsi, faire oublier que c’est le principe lui-même qui est insuffisant. […]
DÉVELOPPEMENT IMPLIQUE SOUS-DÉVELOPPEMENT
D’autre part, la notion de développement implique la notion globale et générale de sous-développement. Elle fait relever du même dénuement, du même manque fondamental, ceux qui ne sont pas parvenus à la situation des pays occidentaux, ignorant ainsi les diversités des cultures et pas seulement celles des grands ensembles existant depuis des millénaires mais aussi de petites nations très anciennes n’ayant que des traditions orales, comme les nations des peuples d’Amazonie ou d’autres régions du monde. Le développement suppose un monde privé de tout, ignorant que ces cultures comportent des superstitions, des erreurs, des mythes, comme la nôtre en comporte aussi – y compris le mythe de la supériorité de l’Occident –, mais elles peuvent comporter également des connaissances, des savoir-faire, des savoir-vivre, des arts de vivre. Par exemple, l’ethnopharmacologie reconnaît de plus en plus la valeur curative de bien des connaissances des populations indiennes d’Amazonie sur la faune et la flore. […] Donc l’idée de sous-développement a en elle-même quelque chose d’abject parce qu’on cesse de voir les individualités et la réalité de cultures existantes. […] Si l’on pense que l’idée de développement a un modèle, celui de nos sociétés, on observe que nos sociétés elles-mêmes subissent une crise spécifique à laquelle leur propre développement conduit et, de plus, tendent vers une série de catastrophes à cause du développement. Dans les sociétés où de nombreuses couches de la population accèdent à ce qu’on appelle le bien-être – le bien-être matériel (confort, télévision, voitures, vacances, etc.) – ce bien-être sécrète en même temps un mal-être, un mal-vivre dont témoignent, notamment en France, la consommation d’innombrables somnifères, tranquillisants, euphorisants et drogues diverses, qu’on ingurgite pour gagner une certaine paix de l’âme ; ce dont témoignent les appels et les ouvertures vers le yogisme, le bouddhisme zen – le succès actuel du Dalaï Lama n’est pas seulement du show business, il correspond à quelque chose de profond… […]
SURVIVRE DANS NOTRE CIVILISATION
La vie dans nos mégapoles est une vie où les nuisances de tous ordres se multiplient et nous asphyxient. Nous essayons de survivre dans notre civilisation en alternant week-ends, loisirs, vacances, ce qui nous fait supporter cette vie de contraintes. Notre société aujourd’hui, la société urbaine, la société de travail, obéit à une logique qui est la logique de la machine artificielle. Nous avons créé des machines. Elles sont hyper spécialisées et hyper chronométrées. On nous demande d’être hyper spécialisés et hyper chronométrés. Or les sociétés ne sont pas des machines triviales, des machines déterministes banales. Les sociétés ont quelque chose de plus et les humains en tant qu’individus ne sont pas des machines. L’égocentrisme individuel a provoqué la destruction des solidarités traditionnelles, de la grande famille, du village, du quartier, du travail, au profit de solidarités nouvelles mais bureaucratiques. Ivan Illich, dans les années 1970, avait très bien fait le diagnostic de cette dégradation de la qualité de la vie, quand il prônait la convivialité. Il y a eu une perte de certaines qualités existant encore dans d’autres cultures qui n’ont pas connu le développement. Ce qu’on a gagné s’est traduit par quelque chose qu’on a perdu, et donc, ce n’est pas la solution. Mais comment concilier ce mieux-être économique, ce développement, cette industrialisation avec la sauvegarde de valeurs de solidarité, voire de responsabilité ? Parce que chez nous aussi, la responsabilité est atteinte. Quand on est responsable d’un tout petit secteur spécialisé dans son entreprise, dans son administration, on perd le sens de la responsabilité de l’ensemble. Et si notre science nous donne tellement de connaissances, celles-ci sont tellement séparées les unes des autres et cloisonnées qu’on n’apprend jamais dans nos universités et nos écoles à lier le local au global, le singulier au général. Et qu’on devient myope. Bien sûr, les autres sociétés, aussi, sont myopes sur l’avenir du monde, mais, nous-mêmes, nous sommes les artisans de cette époque planétaire et restons incapables de la comprendre et de la connaître. Parmi ces facteurs de crise, il y a la crise écologique, problème qui est devenu véritablement mondial, et cette crise de la biosphère est provoquée par le développement lui-même. Arrive alors la formule du développement soutenable. Soutenable signifie qu’il faut tenir compte des rétroactions des dégradations écologiques multiples sur notre vie et notre civilisation, sinon la poursuite du développement tel quel nous conduira à de véritables catastrophes. Deuxièmement, on introduit quelque chose de plus, que montre bien l’œuvre du philosophe Hans Jonas, le principe de responsabilité : nous devons être responsables pour les générations futures. Mais la «soutenabilité» va-t-elle nous permettre de corriger les défauts principaux du développement ? Personnellement, je ne le pense pas. Pourquoi ? Parce que, je le répète, la planète en développement est un vaisseau spatial propulsé par quatre moteurs : la science, la technique, l’industrie, le profit. Ces quatre moteurs n’ont aucun contrôle ; les passagers se disputent entre eux de plus en plus. Et nous allons vers quoi ? Vers la dégradation généralisée de la biosphère ? Vers une série de conflits qui seront couronnés par l’utilisation de l’arme nucléaire ? Car ce danger ne s’est pas du tout atténué depuis la fin de la guerre froide, il s’est multiplié et disséminé. Donc ce n’est pas seulement sur cette voie qu’il faut ralentir. Encore faut-il, si on veut ralentir, que les pays avancés dans cette voie donnent un exemple aux pays qui ne disposent pas du minimum économique ou industriel. […]
UNE VISION ABSTRAITE DE LA PLANÈTE
Quelques-uns des maux les plus profonds dont souffrent les pays sous-développés proviennent du fait que des pays avancés leur imposent certaines façons de se développer ; par exemple des monocultures intensives dans des régions où il y avait auparavant la polyculture… C’est une vision tout à fait abstraite de la planète qui domine. Comment changer de voie ? La difficulté est énorme. Des idéaux peuvent nous éclairer… Plutôt que de s’aliéner sans cesse dans le développement technique, économique et matériel, renverser les choses et essayer de subordonner ces éléments matériels et techniques au développement des relations véritablement humaines, non seulement au sein de chaque pays, ou de chaque civilisation, mais aussi entre les différents humains de la planète. Certaines notions incluses dans le développement peuvent être intégrées. Il est évident que je ne souhaite pas la suppression du marché. Mais au lieu d’un marché livré à ce système dit néolibéral, où l’économie est censée trouver d’elle-même ses propres régulations, je suis pour un marché comportant des régulations qui elles-mêmes devraient être de nature planétaire – ce qui n’existe pas encore. Économie plurielle, commerce équitable, éthique dans l’économie, limitations aux profits… des modèles alternatifs se développent mais ne sont encore malheureusement qu’à l’état embryonnaire. […]
POUR UNE POLITIQUE DE L’HUMANITÉ ET UNE POLITIQUE DE LA CIVILISATION
Il faut donc intégrer beaucoup de choses mais aussi dépasser la notion de développement, avec deux idées : une politique de l’humanité et une politique de la civilisation. De très nombreuses populations supportent des souffrances et des humiliations très profondes que, sans le savoir ou le sachant, les pays hégémoniques imposent. Je le répète, tout n’est pas seulement dans la pauvreté matérielle, mais aussi la façon dont on est considéré. Donc une politique de l’humanité viserait à traiter en priorité les problèmes les plus brûlants et les plus urgents de l’humanité. Quand je parle d’une politique de la civilisation, il ne s’agit pas uniquement de la civilisation occidentale. Depuis le XVIe siècle, l’Occident a imposé une domination extrêmement cruelle, barbare, comportant esclavage, destruction de populations, et en même temps cet Occident a produit lui-même les foyers des antitoxiques puisque c’est là que se font formées les idées émancipatrices. Quand Bartholomé de Las Casas démontre aux théologiens espagnols que les indigènes d’Amérique ont une âme et sont des humains comme les autres, quand Montaigne affirme que les «barbares» sont des hommes qui ont une autre civilisation, quand Montesquieu écrit les Lettres persanes, etc. L’Occident a été le foyer de ces idées qui, prises en mains par les colonisés, leur ont permis de s’émanciper. Et encore aujourd’hui, il y a des apports. Un autre héritage extrêmement ténu mais très profond vient de notre culture européenne, c’est la rationalité autocritique, la capacité de nous critiquer nous-mêmes. Il est évident que les institutions démocratiques qui se sont développées dans les pays d’Europe occidentale, les droits de l’homme, les droits de la femme, toutes ces notions-là font partie, doivent être intégrées dans la civilisation planétaire. Mais il y a d’autres sagesses, d’autres apports de pensée – je pense à la Chine, aussi bien au Taoïsme qu’au Confucianisme, aux philosophies de l’Inde, et même aux conceptions du monde de petits groupements d’Amérique latine (que l’on peut connaître grâce aux livres parus dans la collection Terre Humaine de Jean Malaurie). Je ne sais pas si c’est Césaire ou Senghor qui disait «pour aller vers le rendez-vous du donné et du recevoir». Ce n’est pas nous qui apportons la formule et il y a échange. La civilisation, c’est une civilisation de symbiose, de métissage. […] Nous devons aller vers une civilisation planétaire mais alors le mot développement peut-il avoir encore un sens ? N’apporte-t-il pas plus d’inconvénients que d’avantages ? Continuer à déclarer, sur une sorte de ritournelle, «développement durable !», «développement durable !», c’est un peu comme le «Marchons !» des grenadiers sur la scène de l’opéra. Et nous qui sommes des développés, qu’est-ce qu’on va développer encore plus durablement ? Le problème n’est-il pas de gérer à partir de ce que nous avons, vers un épanouissement humain ? Faut-il que Paris double le nombre de ses habitants, que les campagnes soient de plus en plus désertifiées ? Non. Aujourd’hui la marche en avant nécessite une certaine marche en arrière. […] Ce qui va contre le courant principal et qui, déjà, se manifeste un peu partout, notamment chez nous, se fait de façon dispersée, spontanée. Aucun parti politique n’a pris en charge tous ces exemples minimes qui existent, n’a montré qu’il y avait un sens, ce sens que j’appelle politique de la civilisation. On pense que la croissance va tout résoudre. Pourquoi ? Parce qu’elle va diminuer le nombre de chômeurs. Mais n’y a‑t-il pas d’autres moyens que cette croissance pour donner du travail à tous ? N’y a‑t-il pas des métiers de solidarité à créer ? Les États ne pourraient-ils pas financer des grands travaux, ne serait-ce que la multiplication des parkings souterrains autour des villes pour que les centres-villes deviennent piétonniers et humanisés ? N’y a‑t-il pas une politique d’humanisation à faire ? Comment compter sur la croissance alors que cette croissance nous entraîne justement vers des maux et des nuisances contre lesquels nous devons lutter ? Et le mot soutenable, lui, va-t-il suffire pour essayer d’empêcher ces maux ? Ce sont les questions que je pose. Je sais que la grande difficulté c’est justement de concevoir ces nécessités de changer de voie. Il faut modifier la voie. Et c’est ça qui sera l’effort historique futur, du moins c’est ce que j’espère.
Extrait du dossier de L’Actualité Poitou-Charentes réalisé par Anh-Gaëlle Truong à l’occasion du séminaire sur les enjeux du développement durable organisé par l’Espace Mendès France et l’Institut des risques industriels, assurantiels et financiers (Iriaf, université de Poitiers) en 2003 et 2004.
Portrait d’Edgar Morin par Claude Pauquet.