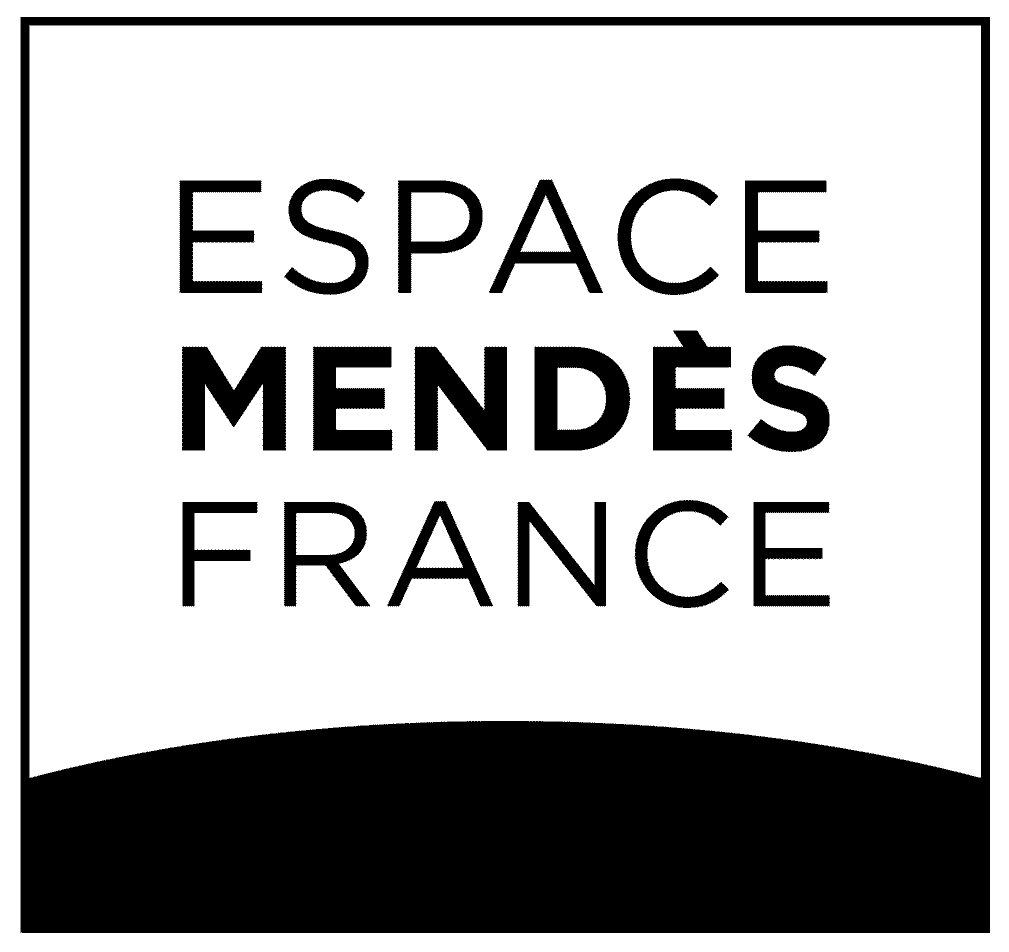Dernier passage de Jean-François Mathé
 Jean-François Mathé en 2008, photo Claude Pauquet
Jean-François Mathé en 2008, photo Claude PauquetPar Jean-Luc Terradillos
«J’adorerais ne laisser d’autre marque dans l’esprit des gens que celle d’un nuage minuscule, tel ceux qu’on aperçoit dans le ciel des tableaux de Magritte. Oui, il s’agirait de ne pas altérer la beauté du monde.» Ainsi s’exprimait dans nos pages (L’Actualité, n° 44) le poète Jean-François Mathé qui s’est éteint le 29 novembre 2023 chez lui dans le Thouarsais. Son petit nuage s’appelle Rougerie, son premier et fidèle éditeur depuis 1973.
Né en 1950 à Fontgombault, Jean-François Mathé a suivi des études de lettres modernes et de philosophie à l’université de Poitiers avant d’enseigner en lycée, à Thouars.
En 2013, il a reçu le grand prix international de poésie Guillevic – Ville de Saint-Malo pour l’ensemble de son œuvre.
Les titres de ses recueils – une vingtaine – sont sobres et rigoureux comme sa poésie : Contractions supplémentaires du cœur (1987, Prix Antonin Artaud), Passage sous silence (1988), Corde raide fil de l’eau (1991), Le Temps par moments (1999, Prix du livre en Poitou-Charentes), Le ciel passant (2002, Prix Kowalski de la ville de Lyon), Agrandissement des détails (2007), Ainsi va (2022).
Ses derniers textes sont plus sombres. L’espace vital se rétrécit.
Vu, vécu, approuvé, publié Le Silence qui roule en 2019, s’ouvre avec ce poème :
«Je serre,
je resserre encore
et encore,
comme si je voulais
que ma vie
soit un fruit
tout entier entré
dans son noyau»
La vie se retire à petit pas, aspirée ; en demeurent le rythme et la délicatesse. Dans Prendre et perdre (Rougerie, 2018) :
«Je n’aime pas les voix
qui transpercent la neige
mais celles qui sont ses flocons
et chantent le ciel à la terre
qui seule entendra la chanson»
En hommage à Jean-François Mathé, voici un entretien publié dans L’Actualité Poitou-Charentes, n° 44 (avril 1999). Un entretien mené par Xavier Person qui vient de publier L’alligator albinos chez Verticales.
Jean-François Mathé ou le passage des oiseaux
L’Actualité. – Tout d’abord, pouvez-vous nous dire l’origine de votre désir d’écrire ?
Jean-François Mathé. – C’est un désir qui m’est venu en marge de ma scolarité. À l’adolescence. Dans sa forme la plus larmoyante et sentimentale tout d’abord. Mais le point de départ véritable se situe pour moi au moment de la lecture de Capitale de la douleur de Paul Eluard. J’y trouvai la révélation du fait que les mots pouvaient s’assembler dans une apparente absurdité. Dans une incongruité. Oui, cette lecture déclencha en moi une surprise, une stupéfaction, qui ne m’ont jamais quitté. Que par exemple on puisse écrire des vers tels que :
Au plafond de la libellule
Un enfant fou s’est pendu
Voilà qui ne laissait pas de m’étonner. À partir de là j’éprouvai une énorme curiosité pour ce que pouvaient signifier de tels assemblages de mots. Ce qui fait que j’ai continué à lire, à rechercher cet étonnement dans la poésie du xxe siècle, essentiellement bien sûr dans le surréalisme.
C’est une découverte liée à l’aventure de la modernité.
Oui. Il s’agissait bien pour moi d’une poésie «postrimbaldienne». La poésie dite classique ne m’aurait pas attiré alors, elle m’aurait semblé n’être que de l’ordre du discours.
Vous commenciez dès alors à écrire ?
J’ai lu beaucoup de poètes du xxe siècle et à chaque fois, dans un cahier, je m’appliquai à écrire un poème «à la manière de». J’ai été un plagiaire. Je faisais mes gammes.
Comment en êtes-vous venu à une écriture plus personnelle ?
Ça s’est dégagé progressivement, au moment où je me suis aperçu que l’écriture me devenait nécessaire, non plus seulement en tant que forme, mais en tant que substance. Une écriture qui dégage ma substance.
Un poète en particulier vous a‑t-il alors influencé ?
La lecture de Philippe Jaccottet m’a beaucoup aidé. C’est quelqu’un qui pratique une poésie assez épurée. Son dépouillement m’a fait considérer comme artificielle toute idée de jeu en poésie. J’ai préféré opter alors pour un registre plus grave. Il y a eu aussi l’influence d’un Jacques Dupin. Bref, des poètes assez sévères, assez exigeants quant à la nécessaire adéquation entre l’écriture et l’expérience vécue. Il est clair en effet que je m’intéresse avant tout à une poésie qui aborde des questions relatives à l’être. Je ne suis pas, selon la terminologie d’Emmanuel Hocquard, un «poète grammairien». Mon désir d’écrire me porte vers un questionnement sur l’existence.
On vous imagine une existence plutôt contemplative, recueillie. L’écriture vous a‑t-elle conduit à un certain choix de vie ?
Oui. La poésie a introduit dans ma vie un grand dégoût de la comédie sociale. Elle m’a aidé à découvrir que l’essentiel est intérieur. Loin des gesticulations. Est-elle une cause ou une conséquence ? Je pense quand même que la poésie me permet de rester en retrait de la comédie sociale, tout en étant heureux. Elle m’apporte ma dose de méditation.
Le thème de la transparence revient souvent dans vos textes :
Je me voudrais immobile
Vitre insensible
Entre voyage et maison
Le poème n’est-il pas pour vous comme une vitre entre le dedans et le dehors ?
Oui. Le poème est une vitre que ne fabriquent pas les vitriers. Grâce à lui, on peut voir du dehors vers le dedans et vice versa. Découvrir des paysages qu’on n’aurait pas imaginés. Mais dans ce motif de la transparence, il y a peut-être aussi un idéalisme mal digéré : ce souhait que tout aille mieux, qu’on puisse remédier à l’incommunicabilité, ménager des circulations entre l’intérieur et l’extérieur.
On pourrait penser à l’attitude d’une certaine mystique, qui tend à l’effacement. Mais il n’y a chez moi aucune dimension religieuse. Je me situerai plus dans la lignée de poètes comme René Char ou Yves Bonnefoy.
Je crois en fait que l’homme est actuellement inaccompli. Le seul dieu que l’homme pourrait mériter, c’est lui-même, en mieux. Il s’agit de se porter à l’extrême de soi-même.
Dans ce motif de la transparence, c’est sans doute le rêve d’un poème où le réel se donnerait à voir en tant que tel, inaltéré.
Oui. C’est une sorte de nostalgie de pureté, d’un accord idéal au monde qu’on ne viendrait pas souiller. Cela ne se fait pas par détermination cependant, mais par moments, par instants. Il ne s’agit pas pour moi de tenir un discours sur le monde. Mais simplement de capter ce qui s’offre dans l’instant. Pour l’essentiel, ma poésie parle de la précarité de tout. Il peut y avoir bonheur, mais éphémère, intermittent. «La vraie vie, c’est par moment», écrit Georges Perros. Il en va de même du poème réussi : l’impression d’avoir capté la vraie vie par moments.
Pourriez-vous définir le poème réussi ?
C’est difficile. Je suis plutôt quelqu’un d’intuitif. Un poème qui tient doit avoir avant tout sa solidité dans le langage. On peut le définir par la négative : un poème m’apparaîtra insuffisant dès lors que je m’apercevrai que je m’y suis laissé aller à l’épanchement. Un poème réussi pour moi est un objet de langage assez stylisé, assez coupant.
«Plusieurs lisent, écrivez-vous, mais c’est à l’envers de leur peau que ce qu’ils cherchent est écrit : à soi-même toujours, on est livre fermé.»
La poésie exprime une sorte de mission impossible. Elle est volonté de connaître l’intérieur, espoir de capter le dehors. Mais il ne s’agit que d’une connaissance instantanée. Le poème, c’est la tentative et, nécessairement, la déception.
«Il n’y a plus qu’à disparaître, visage et pays saisi par la clarté […]» : il y a bien là quelque chose d’extatique.
C’est peut-être un désir de mort au fond, ce désir de s’effacer. Le phénomène de disparition de l’être n’est pas pour moi quelque chose de négatif. Est-ce que le monde n’est pas plus vrai quand on n’est pas là pour en parler ? «Passe, oiseau, passe, et enseigne-moi à passer !», écrit Fernando Pessoa. Je préfère les êtres qui passent, qui ne marquent pas. Avant tout, j’aime la figure du passant. Il ne marque que par le passage, non pas par une possession. J’adorerais ne laisser d’autre marque dans l’esprit des gens que celle d’un nuage minuscule, tel ceux qu’on aperçoit dans le ciel des tableaux de Magritte. Oui, il s’agirait de ne pas altérer la beauté du monde.
Il est clair que les ciels reviennent souvent dans votre poésie, comme nostalgie, comme «appel du vertige».
Quand je parle de beauté du monde, je pense surtout aux grands éléments : la mer, le ciel. Et à cette espèce de conflit, entre l’être humain et ces grands éléments. J’adore la perfection du ciel. Je déteste l’idée d’enracinement, d’attachement. Je ne suis pas l’homme du pays. Je crois que c’est ce que signifie le désir de transparence : une métaphore du refus de posséder un lieu et d’être possédé par lui.
Vous vivez dans un village du Thouarsais, est-ce vraiment malgré vous ?
Il y des raisons familiales et professionnelles à ce choix. Et c’est le choix de la campagne avant tout, pour ses silences, pour le ciel plus vaste ici, aperçu autrement qu’entre deux toits. Mais je ne suis pas un campagnard, dans mon jardin je ne fais que détruire : je tonds, je taille, je désherbe. Il ne s’agit pas pour moi de m’inscrire dans le paysage, mais d’y trouver un certain détachement, loin des bruits, du mouvement.
Vous évoquez dans un poème le fait d’avoir «[…] choisi d’habiter là où une colline monte devant les yeux».
Cette colline s’élève en fait derrière chez moi. Elle fait que notre maison est la première du village à perdre le soleil. On est les premiers à l’ombre. C’est une idée qui ne me déplaît pas, cet apprentissage de son propre crépuscule.
Je voudrais tout de même ajouter que si je n’ai pas à proprement parler «choisi» ce lieu, il me convient parfaitement. C’est une région de beaucoup de ciel, de beaucoup de vent. Une région glissante, de peu d’enracinement. On y éprouve une sensation d’ouverture sur les éléments, mais sans que cela soit spectaculaire. L’influence océanique marque le ciel. J’aime beaucoup ces passages de lumière quand on va du Poitou vers la Charente. Beaucoup plus que dans mon Berry natal, où les haies viennent clore le paysage, j’éprouve ici une sensation d’ouverture. Les variations du ciel y sont très subtiles, entre nuages et éclaircies. On y peut bien voir que tout n’est que passage.